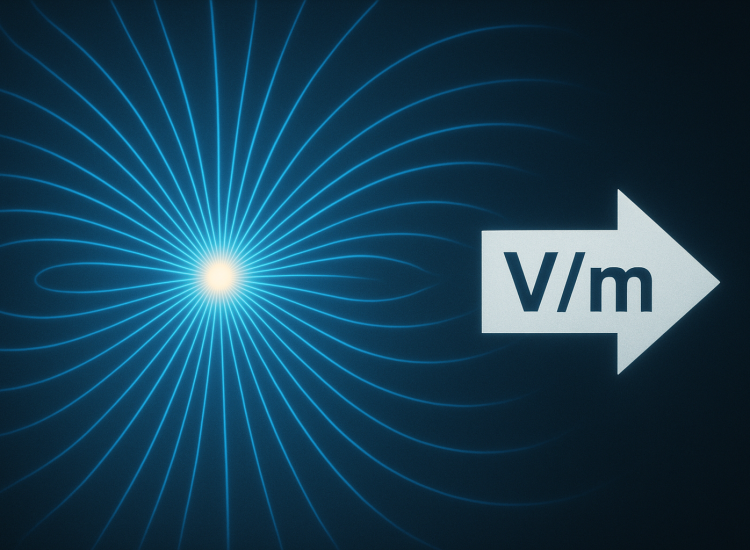Afin de fêter le 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, le président Xi Jinping est venu effectuer une visite d’État dans l’Hexagone les 6 et 7 mai 2024. Étape symbolique, cette visite « amicale » ne reflète pour autant pas la complexité des relations franco-chinoises, qui ont bien évolué depuis la reconnaissance officielle de la République populaire de Chine par la France du général de Gaulle en 1964.
Si les deux pays ont réussi à développer des liens diplomatiques et commerciaux solides, en partie grâce à une histoire commune longue de plusieurs siècles, la France et la Chine ont aussi été confrontées à une multitude de défis et de différends ayant impacté leur relation. Alors que les contextes géopolitiques, économiques et culturels ont évolué rapidement, et sont voués à bouger encore, retour sur l’évolution des relations sino-françaises, et sur les perspectives futures d’une relation qui a toujours été déséquilibrée.
Les relations franco-chinoises entre l’Ancien Régime et le Second Empire et l’affirmation de la domination de Paris sur Pékin
Décrypter les relations franco-chinoises entre l’Ancien Régime et le Second Empire, c’est plonger au cœur d’une saga diplomatique riche en rebondissements et en enjeux géopolitiques. De l’établissement des premiers contacts sous Louis XIV à l’émergence d’une réelle domination française sous Napoléon III, cette période a été marquée par une confrontation complexe entre deux grandes puissances, où se mêlent alliances stratégiques, rivalités commerciales et échanges culturels.
Louis XIV et Kangxi : la genèse des relations diplomatiques franco-chinoises
C’est en 1685 que le roi français Louis XIV décide d’envoyer en Chine six jésuites afin d’entamer des relations diplomatiques avec la dynastie Qing, qui règne sur l’Empire chinois depuis 1644. Les objectifs principaux étaient alors de développer les échanges commerciaux entre la France et la Chine, ainsi que d’améliorer les cartes marines pour accroître la puissance maritime française. Plus spécifiquement, les jésuites avaient aussi à cœur d’évangéliser la Chine, pour que le christianisme puisse se répandre massivement en Orient.
Pour atteindre ces objectifs, les jésuites ont dû s’imprégner de la culture chinoise, aussi bien dans ses aspects linguistiques que civilisationnels. C’est ainsi au travers du prisme culturel que les jésuites ont fini par développer un véritable coup de foudre pour la Chine, qui a ensuite logiquement transparu dans leurs lettres envoyées à la France.
De manière générale, les lettres des jésuites expatriés en Chine étaient très flatteuses, parce qu’il s’agissait avant tout de courtisans du roi. Ces derniers insistaient notamment sur les nombreuses similitudes entre Louis XIV et son homologue Kangxi.
En effet, ces derniers ont été placés très jeunes à la tête de leur pays, ont axé leur règne autour de la centralisation du pouvoir pour gagner en stabilité, et se sont fait connaître pour leurs réformes administratives et leur sagesse politique. Ces despotes éclairés avaient aussi en commun l’amour des arts et des sciences, les conduisant tous deux à avoir fréquemment recours au mécénat pour soutenir les artistes.

Au fil de nombreux voyages, par lesquels vont transiter plusieurs lettres, portraits et cadeaux en tout genre, il s’est ainsi développé une fascination réciproque entre Louis XIV et Kangxi, et donc, entre la France et la Chine. Sous l’influence des jésuites français, Kangxi a notamment introduit à sa cour des éléments de science, de technologie et de culture occidentale. Louis XIV quant à lui, a été très séduit par les « chinoiseries », c’est-à-dire par les arts et les objets décoratifs chinois, qui étaient alors considérés comme exotiques et raffinés.
Seulement, au XVIIème siècle, les relations entre la France et la Chine se résumaient surtout à un partenariat culturel, et n’étaient pas très fructueuses au niveau économique. En cause, le monopole des échanges commerciaux attribué à la Compagnie française des Indes orientales, qui était alors à la ramasse face à la puissance britannique.
Supprimé en 1769, cela a ensuite permis aux acteurs privés de partir plus librement à la conquête du marché chinois, et donc de donner un nouvel élan aux relations sino-françaises. Dans cette continuité, le roi Louis XVI décide en 1776 d’ouvrir un consulat dans le port de Canton, qui était alors le seul à être ouvert en Chine pour le commerce international.
Ce consulat a eu beaucoup de difficultés à se pérenniser. Il a en effet fermé une première fois en 1803, avant de rouvrir en 1827 et de fermer à nouveau en 1839 à cause de la première guerre de l’opium entre le Royaume-Uni et l’empire Qing. Remis en activité par le roi Louis-Philippe en 1842, il a été une énième fois fermé en 1847.
Heureusement pour la France, un traité d’amitié et de commerce signé à Huangpu en 1844 a permis d’installer en 1847 un vice-consulat dans la ville de Shanghai, puis un consulat général en 1859. De belles avancées, mais qui n’ont pas suffi à satisfaire une France avide du commerce chinois.
Napoléon III et la Chine : de la fascination culturelle à la conquête économique
Si Louis XIV, Napoléon Ier ou encore Louis-Philippe avaient une certaine fascination culturelle pour la Chine, ce n’était pas vraiment le cas de Napoléon III, qui voyait surtout en l’Empire du milieu une source intarissable de revenus.
C’est ainsi que l’empereur décide à partir de 1856 de s’engager auprès des Britanniques, et contre la dynastie Qing, dans la seconde guerre de l’opium.
Contextuellement, le Royaume-Uni cherchait activement un moyen d’étendre son commerce de l’opium en Chine, afin d’équilibrer une balance commerciale défavorable due aux importations de thé, de soie et d’autres produits chinois. Seulement, la Chine réprimait à l’époque ce commerce, qui causait de graves problèmes de santé aux Chinois, des sorties massives de trésorerie ainsi que du tort à la stabilité sociale de l’Empire. De ce fait, les Britanniques cherchaient à déclencher un conflit avec la Chine pour pouvoir légitimement satisfaire leurs intérêts.
L’incident de l’Arrow en octobre 1856 leur a donné le prétexte qu’ils cherchaient pour déclencher les hostilités. En effet, l’Arrow était un navire chinois suspecté de piraterie et de contrebande d’opium, autrefois enregistré à Hong Kong, qui était alors sous pavillon britannique.
Si l’enregistrement avait expiré en 1856, il n’empêche que le navire continuait illégalement à arborer ce drapeau. Ainsi, lorsque les autorités chinoises ont décidé d’arrêter l’équipage chinois à son bord, ils ont fait « l’erreur » symbolique d’abaisser le pavillon britannique, ce que la Grande-Bretagne a considéré de manière opportune comme une grave violation de souveraineté.
C’est ainsi que le Royaume-Uni décida d’attaquer la Chine, en compagnie des Français, qui ont justifié leur participation par l’exécution chinoise du missionnaire français Auguste Chapdelaine.
Concrètement, la France de Napoléon III avait deux raisons principales d’intervenir. Premièrement, la volonté d’accéder à davantage de marchés chinois, notamment en Chine du Nord, et deuxièmement le désir de renforcer l’alliance franco-britannique, puisque la Grande-Bretagne était alors le pays le plus puissant au monde.
Sans grande surprise, la France et la Grande-Bretagne n’ont pas mis longtemps à soumettre la Chine, qui a été contrainte de signer en 1860 la Convention de Pékin, qui lui était évidemment défavorable à tous les niveaux.
Galvanisé par cette victoire sans appel, la France s’est par la suite lancée seule dans une guerre contre la Chine entre 1884 et 1885, afin de pouvoir tranquillement prendre le contrôle du Vietnam, alors considéré par la Chine comme État vassal. Là encore, la France s’est imposée largement, lui permettant ainsi de contraindre la Chine à reconnaître le protectorat français sur le Vietnam via la traité de Tiensin.
Ce qui est paradoxal, c’est que le comportement colonial français n’a pas envenimé les relations entre deux pays, parce que les termes du traité de Tiensin n’étaient pas excessivement punitifs pour la Chine, limitant ainsi le ressentiment, puisque la Chine n’a pas subi de pertes territoriales directes autres que l’influence sur le Vietnam. Aussi, la Chine et la dynastie Qing étaient pleinement conscients qu’il était vain de résister à une attaque occidentale, et qu’il valait mieux la jouer profil bas afin de se concentrer sur des réformes internes susceptibles de moderniser et de renforcer le pays face aux pressions externes.
En tout cas, à l’aube du XXème siècle, il était alors clair que le territoire chinois était sous hégémonie occidentale, et presque sous tutelle des puissances européennes. Une situation qui n’a pas perduré longtemps…
L’émergence d’un géant économique chinois et l’affirmation de la domination de Pékin sur Paris
L’étude de l’émergence de la Chine en tant que géant économique et de son influence croissante sur la scène mondiale suscite un intérêt grandissant parmi les chercheurs en sciences politiques et en économie internationale.
Cette évolution spectaculaire, marquée par une croissance économique fulgurante et une montée en puissance sur le plan géopolitique, a radicalement redéfini les rapports de force traditionnels entre les grandes puissances. La France ne fait pas exception, et il est plutôt cocasse aujourd’hui d’observer le retournement de situation de la relation franco-chinoise.
De nouvelles stratégies diplomatiques pour obtenir une reconnaissance officielle : les tactiques victorieuses de la Chine face à la France (1912-1964)
1912 fut l’année de la proclamation de la République de Chine, et par la même occasion, la fin de la vieille dynastie Qing. Affaiblie par des défaites militaires humiliantes et des réformes ratées, la Chine a en effet eu besoin de changement politique pour se moderniser après des siècles de soumission au système féodal et monarchique.
Reconnue dès 1913 par la France, la jeune république a toutefois eu du mal à se stabiliser, la faute à une rupture radicale avec des millénaires de tradition impériale. Face à l’instabilité politique, aux luttes internes et aux ingérences étrangères qui perduraient, nombre d’étudiants ont décidé d’émigrer en direction de la France pour venir étudier ou même travailler.
Ce sont ainsi 4000 jeunes chinois qui ont fait le déplacement dans le cadre du Mouvement Travail-Études, dont nombres de futurs cadres du Parti Communiste Chinois (PCC) tels que Zhou Enlai et Deng Xiaoping.
La relation entre la France et la Chine s’est ensuite renforcée à la suite de l’alliance durant la Seconde Guerre mondiale entre les Forces françaises libres (FFL) de Charles de Gaulle et les troupes chinoises face aux forces de l’Axe. Un engagement qui a été bénéfique pour la Chine, puisque cette dernière a vu lui être restitué à la fin de la guerre le territoire de Kouang-Tchéou-Wan, ainsi que plusieurs comptoirs appartenant jusque-là à la France.
Toutefois, la montée du communisme en Chine a creusé un fossé idéologique entre Paris et Pékin. La proclamation en 1949 de la République populaire de Chine après la victoire de Mao Zedong a effectivement déplu à la France, qui a préféré continuer de soutenir le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek, réfugié à Taïwan, comme gouvernement légitime de la Chine.

Une décision que la Chine communiste a fortement fait payer à la France sur la scène internationale, puisque le pays a en 1950 reconnu le Vietnam communiste, alors en guerre contre la France coloniale, et soutenu le mouvement d’indépendance en Algérie.
La brouille n’a toutefois pas duré éternellement, puisque le retour au pouvoir en France du général de Gaulle s’est accompagné d’une volonté de se rapprocher du bloc communiste, et donc de la Chine, afin de pouvoir notamment prouver que la France était suffisamment puissante pour pouvoir mener une politique étrangère indépendante de celle des États-Unis.
C’est ainsi que la France a officiellement reconnu le 27 janvier 1964 la République populaire de Chine, quatorze ans après le Royaume-Uni, mais quinze ans avant les USA. Cet acte a été particulièrement bien vu à l’époque de la guerre froide par la Chine, ce qui a permis de sceller des liens diplomatiques entre Paris et Pékin, ainsi que de sortir le pays communiste d’un isolement diplomatique qui commençait à devenir pesant.
Révolution culturelle et mondialisation : le changement de statut de la Chine et de ses relations avec la France
Dans les années 1960, les relations diplomatiques entre la France et la Chine ont plutôt été limitées. Quelques visites officielles, échanges culturels ou encore discussions économiques ont bien eu lieu, mais le début de la Révolution culturelle de Chine (1966-1976) a bien perturbé les échanges, et rendu les interactions assez sporadiques à la fin de la décennie.
Les années 1970 furent quant à elles l’occasion d’un renforcement progressif des relations. En 1973, le Premier ministre français de l’époque, Pierre Messmer, a notamment fait une visite remarquée en Chine, de même que son homologue Zhou Enlai en France en 1975. D’un point de vue économique, les années 1970 furent aussi l’occasion pour Paris et Pékin d’entamer une relation solide en matière d’aéronautique et de défense, en témoigne notamment la fourniture de sonars et d’hélicoptères français à la Chine.
Les liens entre la France et la Chine se sont ensuite intensifiés dans les années 1980, d’une part grâce à la mort de Mao Zedong en 1976, et d’autre part grâce à l’ouverture au monde de la Chine, liée aux réformes économiques de Deng Xiaoping ayant débuté à partir de 1978. Nombre d’accords de coopération sont ainsi signés cette décennie-là entre la France et la Chine, dans des domaines aussi élargis que l’industrie, la technologie et la culture, permettant par cela notamment à Peugeot et à Alstom de partir à la conquête du marché chinois.
Si la relation était jusqu’ici surtout dominée par la France, qui était alors une puissance mondiale incontestablement supérieure à la Chine, tout a changé très rapidement. En effet, les réformes économiques de Deng Xiaoping ont eu un succès si fulgurant qu’on estime à 9.5% la croissance annuelle de la Chine de 1978 à 2014, contre environ 2% par an pour la France à la même période.
De ce fait, le rapport de force entre la Chine et les puissances occidentales a évolué dès les années 1990, en témoigne par exemple le rétablissement rapide des dialogues diplomatiques et économiques avec Pékin après le massacre de Tiananmen en juin 1989. Derrière, la Chine a confirmé sa dynamique vertigineuse, et son nouveau statut sur la scène internationale, en doublant son PIB entre 1991 et 1996 (413.4 milliards de dollars à 863.7).
C’est ainsi qu’en 2005, la Chine a officiellement dépassé la France en termes de PIB, bien aidée par son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui lui a permis d’accélérer son intégration dans l’économie mondiale en faisant augmenter considérablement ses exportations. Devenu leader mondial dans plusieurs industries liées à l’électronique et aux télécommunications, la Chine n’a ensuite eu dans les années 2000 et 2010 qu’à se moderniser militairement et à se renforcer géopolitiquement via ses Nouvelles routes de la soie pour devenir aujourd’hui le rival direct des États-Unis.
Les relations France-Chine aujourd’hui et demain : vers un sursaut d’orgueil de l’Hexagone ?
En l’espace d’un demi-siècle, la France est clairement devenue inférieure à la Chine. Pékin a effectivement un PIB nominal six fois supérieur à Paris, dispose d’un budget militaire bien plus élevé, d’une armée beaucoup plus grande et avancée technologiquement, ainsi que d’une influence mondiale bien plus significative lui permettant de rivaliser avec Washington.
Si la France et la Chine coopèrent aujourd’hui dans de nombreux domaines, allant de l’aéronautique à l’automobile sans oublier l’agro-alimentaire et les services aux personnes âgées, il n’empêche que la relation est loin d’être égalitaire.
Troisième partenaire commercial de la France, la Chine est aussi de fait son premier déficit commercial bilatéral. Concrètement, l’Hexagone importe bien plus de biens et de services de la Chine qu’elle n’en exporte, si bien que le déficit s’élevait en 2023 à 46.3 milliards d’euros, après avoir atteint 53.6 milliards en 2022. Un manque abyssal de réciprocité que la France ne parvient pas à combler et à rééquilibrer.
Par ailleurs, la France est aussi dépendante économiquement de la Chine. Avec 2 millions de touristes chinois en 2019, ayant effectué pour pas moins de 3.5 milliards de dépenses, la Chine est clairement un atout indéniable pour le soft power français. Si on ajoute à cela le fait que Pékin ait acheté la même année des Airbus pour 30 milliards d’euros, il devient clair que la France ne peut se permettre de se brouiller avec son allié.
C’est la raison pour laquelle Paris est resté plutôt silencieux quant aux atteintes chinoises aux droits de l’Homme, plutôt récurrentes ces dernières décennies. Du massacre de la place Tiananmen aux atteintes aux droits du peuple tibétain sans oublier récemment la répression des Ouïghours, la France n’a ainsi délibérément pas fait de vagues, la préservation des intérêts économiques étant plus importante que le reste.
Géopolitiquement, Emmanuel Macron a également appelé en avril 2023 l’Union européenne à ne pas être « suiviste » des États-Unis quant à la situation à Taïwan, montrant là encore une volonté de ne pas froisser le régime chinois. Mais la France a-t-elle vraiment intérêt à se tourner de plus en plus vers la Chine, au détriment des États-Unis ?
D’un point de vue économique, il y a une certaine logique, surtout à l’heure où la Chine a pour objectif de devenir première puissance mondiale en 2050. Il y a aussi une pertinence dans le sens où l’affirmation de l’indépendance française et européenne sur la scène internationale passe aussi par le fait de couper le cordon avec la politique étrangère des États-Unis et de l’OTAN, qui pourraient bien lâcher la France assez rapidement…
Toutefois, Paris et Pékin sont fondamentalement opposés sur leur vision de l’évolution du monde. La France et l’Europe cherchent en effet à renforcer un ordre mondial basé sur des valeurs universelles et des institutions internationales robustes, tandis que la Chine promeut quant à elle un multilatéralisme plus pragmatique et axé sur le développement, la souveraineté nationale et des réformes qui reflètent les réalités économiques actuelles.
Aujourd’hui, ce pragmatisme chinois se manifeste par une sorte de neutralité et d’inaction sur les conflits entre la Russie et Ukraine et entre Israël et la Palestine, parce que le pays est purement rationnel, et sait qu’il n’a pas intérêt à intervenir dans des conflits qui ne le concernent pas directement, et qui monopolisent en plus de cela l’attention de ses principaux adversaires. Or, la France est-elle vraiment prête à renforcer ses liens avec une nation défendant des principes et des valeurs qui sont opposés au projet européen ?
Si la France et l’Europe souhaitent gagner en indépendance et en autonomie sur la scène internationale, elles auraient plutôt intérêt à garder une distance avec la Chine, sous peine de continuer à se faire dévorer dans le futur, et de devenir à terme ses vassaux. Trop faible pour l’instant pour survivre seule dans un monde multipolaire, l’Europe va devoir bientôt faire un choix majeur pour son avenir : soit se renforcer dès maintenant pour préparer une scission avec les États-Unis, ce qui passe entre autres par la construction d’une armée européenne, soit se résigner à rester sous le joug américain, en s’assurant toutefois de garder une cohérence quant à sa vision du monde.
Quelques liens et sources utiles :
Françoise Kreissler, Sébastien Colin, La France et la République populaire de Chine: Contextes et répercussions de la normalisation diplomatique (1949-1972), Editions L’Harmattan, 2017
Sonia Bressler, Soixante ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine, LA ROUTE, 2024