Histoire des femmes : entre silences, luttes et résurgences
On l’a longtemps résumée à quelques noms. Jeanne d’Arc, Marie Curie, Simone de Beauvoir. Trois exceptions, posées comme des modèles, parfois comme des anomalies. Pendant des siècles, l’histoire des femmes n’a pas été racontée. Elle a été tue, déplacée, effacée. Les femmes n’étaient pas considérées comme des sujets historiques, sauf lorsqu’elles épousaient, donnaient naissance ou régnaient.
Il ne s’agit pas d’ajouter des noms à une liste déjà écrite. Il s’agit de revoir la structure même du récit historique. Replacer les femmes dans l’histoire, ce n’est pas les y insérer de force, c’est reconnaître qu’elles y étaient déjà — actrices, victimes, créatrices, résistantes — mais que leur trace a été négligée, marginalisée ou volontairement écartée.
Invisibles, mais présentes
Les archives parlent rarement directement des femmes, sauf quand elles dérangent l’ordre. Prostituées, sorcières, criminelles, hystériques. On retrouve leur trace dans les marges : procès, rapports de police, prescriptions médicales. Pourtant, elles tissent la trame du quotidien, dans les familles, les champs, les marchés, les ateliers. Elles soignent, éduquent, travaillent, écrivent, parfois dans l’ombre d’un nom masculin.
L’histoire des femmes commence par une lecture différente des sources. Elle exige de fouiller autrement : lire entre les lignes, observer les silences, questionner les absents. Car l’absence n’est jamais neutre. Elle signale un choix.
Le pouvoir au féminin : exception ou stratégie ?
L’histoire politique a longtemps opposé le pouvoir à la féminité. Pourtant, des femmes ont gouverné : Aliénor d’Aquitaine, Blanche de Castille, Christine de Suède, Catherine de Médicis. Mais elles ont souvent dû ruser, se déguiser symboliquement en hommes, parler au nom d’un mari, d’un fils, d’un roi absent.
Ces reines ou régentes ne s’inscrivent pas toujours dans une logique féministe, mais elles montrent que l’ordre masculin du pouvoir n’est jamais aussi stable qu’il le prétend. Le règne féminin est perçu comme un désordre temporaire, une anomalie tolérée, rarement célébrée.
Le corps comme territoire de contrôle
Le corps féminin, dans l’histoire, n’est jamais libre. Il est objet de normes religieuses, médicales, morales. On le couvre, on l’examine, on le juge. On régule sa sexualité, sa fécondité, son silence ou sa parole. L’histoire de l’avortement, de la contraception, de la maternité forcée ou empêchée, en est un symptôme criant.
Les manuels d’obstétrique, les traités de morale, les sermons religieux révèlent un long processus de dépossession. Le corps des femmes appartient à d’autres : au mari, à l’Église, à l’État. Mais cette histoire n’est pas seulement une suite de répressions. Elle est aussi faite de résistances.
Des sages-femmes clandestines, des guérisseuses traquées, des militantes médicales, des écrivaines anonymes construisent, en marge, une contre-histoire des corps.
L’éducation, la lente conquête du savoir
Exclues longtemps des universités, les femmes ont pourtant toujours appris. À la maison, dans les couvents, en autodidactes. Certaines lisent en cachette, tiennent des journaux, écrivent sous pseudonyme. Le XIXe siècle voit émerger les premières écoles secondaires pour filles, mais leurs contenus restent limités : couture, maintien, morale chrétienne.
C’est seulement au XXe siècle que l’accès aux études supérieures devient une réalité élargie. Mais l’histoire de ces batailles scolaires est encore trop peu racontée. Les noms de Julie-Victoire Daubié, Madeleine Pelletier, Marguerite Durand ou Hélène Metzger mériteraient d’occuper les mêmes places que ceux des fondateurs de l’école républicaine.
Car l’accès au savoir n’a jamais été un simple progrès technique. Il a été une lutte politique, sociale, symbolique.
Travail : présence, oubli, réapparition
Les femmes ont toujours travaillé. Dans les champs, les manufactures, les foyers, les marchés. Mais ce travail a rarement été reconnu comme tel. On l’a appelé « aide », « activité complémentaire », « fonction maternelle ». On l’a exclu des statistiques, des contrats, des salaires.
L’industrialisation ne marque pas leur entrée dans l’économie, mais leur transformation en main-d’œuvre visible. Dans les usines de textile, dans les arsenaux, elles deviennent indispensables, surtout en temps de guerre. Mais dès la paix revenue, on les renvoie à la maison. La norme reste celle de l’homme-pourvoyeur et de la femme-éduquante.
Ce modèle s’effondre lentement. Les revendications syndicales féminines émergent, souvent dans l’indifférence. Elles concernent les salaires, mais aussi la dignité, la sécurité, le droit au respect. L’histoire du travail féminin est indissociable d’une critique du capitalisme sexué.
Luttes, féminismes et contre-discours
À partir du XIXe siècle, des mouvements féminins structurés apparaissent. Droit à l’éducation, droit de vote, droit à l’indépendance. Mais le féminisme n’est pas un bloc. Il est traversé de courants, de contradictions, de conflits. Il est ouvrier, bourgeois, chrétien, laïque, noir, lesbien, radical, réformiste.
Chaque vague porte ses priorités, ses héroïnes, ses silences aussi. Les suffragettes britanniques ne parlent pas des femmes colonisées. Les féministes françaises des années 1970 oublient souvent les questions raciales. Mais chaque mouvement déplace les lignes.
L’histoire des femmes est aussi celle des féminismes, de leurs tensions internes et de leur capacité à renouveler les récits. Elle oblige à complexifier, à croiser les dominations, à refuser les généralités confortables.
Une mémoire encore fragile
Aujourd’hui, des figures réapparaissent. Des noms oubliés sont réhabilités, des trajectoires sont réécrites. Mais la mémoire de l’histoire des femmes reste lacunaire. Peu de rues, peu de statues, peu de chapitres leur sont consacrés. L’invisibilisation persiste, souvent par habitude, parfois par stratégie.
L’histoire des femmes n’est pas une annexe. Elle est une méthode, une exigence, une forme d’honnêteté intellectuelle. Elle ne se limite pas à faire place. Elle oblige à repenser les structures mêmes du récit historique.




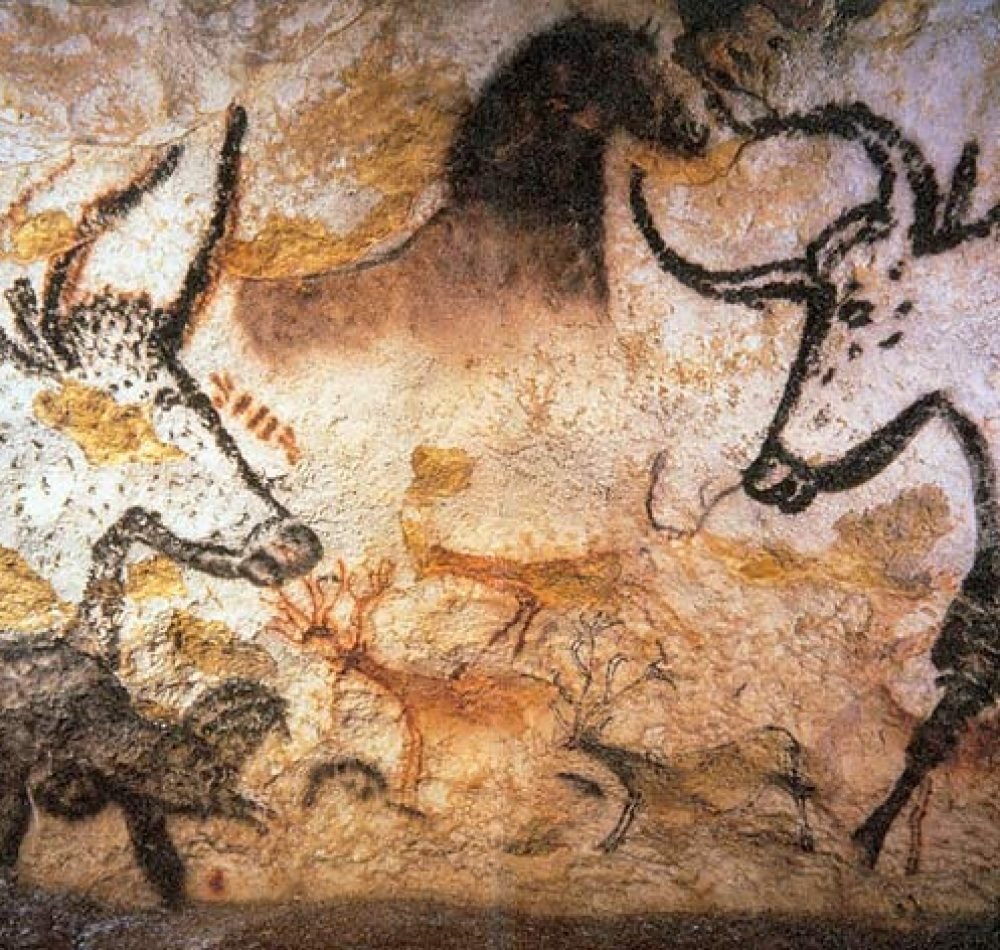




![[Image d’illustration] Départ de la famille de Boabdil de l’Alhambra. L’œuvre représente le moment où Boadbil (1459-1533), le dernier roi musulman de Grenade, a quitté le palais de l’Alhambra avec sa famille après la prise de Grenade par les Rois Catholiques en 1492 – Manuel Gómez-Moreno González | Domaine public [Image d'illustration] Départ de la famille de Boabdil de l'Alhambra. L'œuvre représente le moment où Boadbil (1459-1533), le dernier roi musulman de Grenade, a quitté le palais de l'Alhambra avec sa famille après la prise de Grenade par les Rois Catholiques en 1492 - Manuel Gómez-Moreno González | Domaine public](https://revue-histoire.fr/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Loeuvre-represente-le-moment-ou-Boadbil-1459-1533-le-dernier-roi-musulman-de-Grenade-a-quitte-le-palais-de-lAlhambra-avec-sa-famille-apres-la-prise-de-Grenade-par-les-Rois-Catholiques-en-1492-qaa09jakdde4bx9n8md1nlwrmia9d4xyow471o9hy4.jpg)








