Choisir une méthodologie mémoire solide, c’est organiser un parcours scientifique faisable et probant. Cet article propose une démarche complète : cadrage de la question, positionnement dans l’historiographie, constitution du corpus, méthodes d’analyse et calendrier d’écriture.
Vous y trouverez des repères concrets pour transformer une idée générale en enquête structurée, sourcée et reproductible, en respectant les exigences universitaires de rigueur, de citation et d’éthique, depuis les premiers repérages jusqu’à la soutenance.
Définir le cadre scientifique
Avant les archives, clarifiez ce que vous cherchez, pourquoi, et comment vous le démontrerez. Ce cadrage oriente tout le reste.
Question de recherche et hypothèses
Formulez une problématique ouverte qui met en tension mécanismes et limites. Énoncez une hypothèse principale et, si besoin, des hypothèses secondaires. Vérifiez la faisabilité : disposez-vous d’indices, d’exemples et d’un accès réaliste aux sources ? Une bonne question appelle un plan en deux ou trois mouvements et anticipe les preuves attendues. Reformulez en une phrase-thèse provisoire ; elle guidera le dépouillement, l’échantillonnage et la rédaction, en évitant les détours descriptifs.
État de l’art et positionnement
Dressez un panorama raisonné des travaux : thèses, articles, chapitres, catalogues. Situez les débats, repérez les angles morts, explicitez l’apport attendu du mémoire. Sélectionnez quelques auteurs de référence et précisez votre position : prolongement, nuance, contre-argument. Ce positionnement évite la paraphrase et oriente la collecte : on lit pour répondre à la question, pas pour accumuler. Notez systématiquement les références ; une bibliographie vivante facilite la relecture critique et sécurise la citation.
Cadre théorique et concepts
Choisissez des concepts opératoires (acteurs, échelles, temporalités) et définissez-les précisément. Expliquez pourquoi ce cadre est pertinent pour votre terrain : que permet-il de voir, que laisse-t-il de côté ? L’objectif n’est pas de multiplier les étiquettes, mais d’outiller l’analyse. Reliez chaque concept à un usage empirique prévu : variable, indicateur, catégorie d’observation. Cette articulation rend les chapitres comparables, clarifie les transitions et prépare une discussion finale convaincante.
Constituer et traiter le corpus
Un corpus défini, accessible et exploitable transforme l’idée en démonstration. La qualité de l’échantillonnage fait la solidité des résultats.
Cartographier les sources et l’accès
Repérez les fonds pertinents (archives, presse, statistiques, iconographie) et leurs conditions d’accès. Listez lieux, cotes, inventaires, délais, droits de reproduction. Cherchez des moyens de substitution (numérisations, microfilms, bases en ligne) pour sécuriser le calendrier. Priorisez les gisements les plus féconds et planifiez des sessions de dépouillement réalistes. Documentez chaque consultation : cette traçabilité vous évitera pertes d’informations et vous permettra de justifier vos choix méthodologiques.
Échantillonnage et critères d’inclusion
Définissez le corpus : bornes temporelles, aire géographique, types de documents. Énoncez des critères d’inclusion/exclusion et testez-les sur un micro-échantillon. Ajustez si la matière est trop rare ou trop abondante. Un corpus surdimensionné dilue l’analyse ; un corpus trop mince fragilise les conclusions. Visez un équilibre : diversité suffisante pour comparer, homogénéité pour cumuler des preuves. Notez les biais structurels (lacunes, séries interrompues) et encadrez leur effet sur l’interprétation.
Méthodes d’analyse et outils
Choisissez des méthodes compatibles avec vos matériaux : critique interne/externe, sériation, analyse quantitative, étude prosopographique, cartographie, analyse iconographique. Définissez vos unités d’observation et vos catégories. Outillez-vous sobrement : gestion bibliographique, tableur, base simple, logiciel de prise de notes. La règle : un outil par usage, pas l’inverse. Prévoyez des contrôles croisés (double codage, vérification ponctuelle) pour évaluer la robustesse et limiter les erreurs d’interprétation.
Planifier, écrire, vérifier
Un rétroplanning réaliste, une écriture régulière et une vérification méthodique garantissent la tenue du projet.
Rétroplanning et jalons
Construisez un calendrier : repérage, dépouillement, analyse, rédaction, révisions. Fixez des jalons mesurables (chapitre rédigé, tableau finalisé, carte validée). Laissez des marges pour aléas d’accès aux fonds et retours de direction. Tenez un journal de bord : décisions, hypothèses, problèmes rencontrés. Ce pilotage rend visibles vos avancées, facilite les rendez-vous avec l’encadrant et évite les blocages tardifs juste avant la date de dépôt.
Rédaction continue et preuves
Écrivez tôt et souvent : un paragraphe par idée, appuyé par une preuve claire (extrait, chiffre, carte, cliché) et une référence située. Chaque section commence par une phrase-thèse et se referme sur un bilan. Bannissez les digressions ; reliez constamment observation et question. Standardisez vos tableaux et légendes. Citez court, commentez immédiatement. La lisibilité formelle (titres, numérotation, renvois) est un facteur d’évaluation autant qu’un gain de compréhension.
Éthique, citation et protection des données
Respectez l’éthique : autorisations de consultation, anonymisation si nécessaire, mention des limites. Uniformisez la citation (style choisi, cohérence stricte) et indiquez toujours les cotes ou URL pérennes. Pour les images, précisez auteur, source, date, licence. Ne diffusez pas de données sensibles sans cadre clair. Cette rigueur protège votre travail, crédibilise vos résultats et facilite la vérification par le lecteur ou le jury.
Les questions qu’on se pose sur méthodologie mémoire
Comment savoir si ma question est trop large ?
Testez-la : pouvez-vous formuler deux arguments étayés et trouver rapidement trois preuves distinctes ? Si tout rentre sans choix, l’angle est trop ample ; si rien n’alimente l’analyse, il est trop serré. Ajustez période, espace ou acteurs jusqu’à obtenir une question ambitieuse mais maîtrisable.
Faut-il un chapitre « méthodes » séparé ?
Oui si vos méthodes sont centrales (collecte originale, protocole d’analyse). Sinon, explicitez brièvement principes, corpus et outils en introduction, puis rappelez les choix techniques au début des chapitres. L’important est la transparence : le lecteur doit comprendre comment les résultats ont été produits.
Comment gérer un corpus hétérogène ?
Regroupez par familles de documents et définissez des règles d’analyse adaptées à chacune. Indiquez les limites de comparabilité. Utilisez des tableaux de correspondance pour harmoniser les catégories. La cohérence vient des questions posées et des critères de codage, pas de l’uniformité artificielle des matériaux.
Quand figer le plan ?
Figez un plan provisoire après vos premiers tests de corpus. Acceptez des ajustements tactiques, mais évitez de tout remanier après la moitié du dépouillement. Toute modification doit améliorer la réponse à la problématique, pas seulement l’esthétique du sommaire.
Quelle place donner à l’historiographie ?
Sélectionnez les travaux utiles et montrez ce qu’ils expliquent ou ignorent de votre terrain. Articulez vos résultats à ces positions dans la discussion finale. L’objectif n’est pas de réciter, mais de situer votre contribution et d’en prendre la mesure.
Les points clés à retenir
- Problématique faisable, hypothèses explicites, concepts opératoires.
- Corpus défini par critères d’inclusion, accès sécurisé et traçabilité.
- Méthodes compatibles avec les matériaux, contrôles croisés prévus.
- Calendrier jalonné, écriture continue, preuves analysées et sourcées.
- Éthique et citation uniformisée, limites et biais clairement signalés.
Quelques liens et sources utiles
Vassili Joannidès de Lautour, Méthodologie du mémoire de fin d’études et de la thèse professionnelle, ELLIPSES, 2017
Sophie Boutillier, Nelly Labère, Alban Goguel d’Allondas, Dimitri Uzunidis, Méthodologie de la thèse et du mémoire, STUDYRAMA, 2022
Salvatore Marteddu, Outils et méthodologie de mémoires de recherche et/ou à visée professionnelle en sciences humaines et sociales, CAFEURIS, 2022



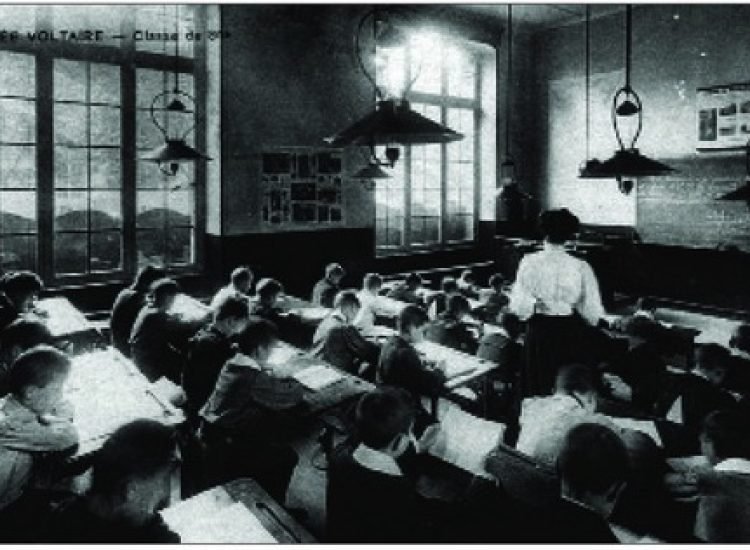
![Miniature d’un manuscrit enluminé représentant un combat de la deuxième croisade de Louis VII, venu à l’aide du roi de Jérusalem Baudoin III contre les armées arabes, au milieu du XIIe siècle – Guillaume de Tyr, Histoire d’Outremer, XIVe siècle [BnF, département des Manuscrits] | Domaine public Miniature d'un manuscrit enluminé représentant un combat de la deuxième croisade de Louis VII, venu à l'aide du roi de Jérusalem Baudoin III contre les armées arabes, au milieu du XIIe siècle - Guillaume de Tyr, Histoire d'Outremer, XIVe siècle [BnF, département des Manuscrits] | Domaine public](https://revue-histoire.fr/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Miniature-dun-manuscrit-enlumine-representant-un-combat-de-la-deuxieme-croisade-de-Louis-VII-venu-a-laide-du-roi-de-Jerusalem-Baudoin-III-contre-les-armees-arabes-au-milieu-du-XIIe-siecle-qug9dp4rm9bcne8wo1sa9m1watzk4emeq8wnrdtvcs.jpg)


