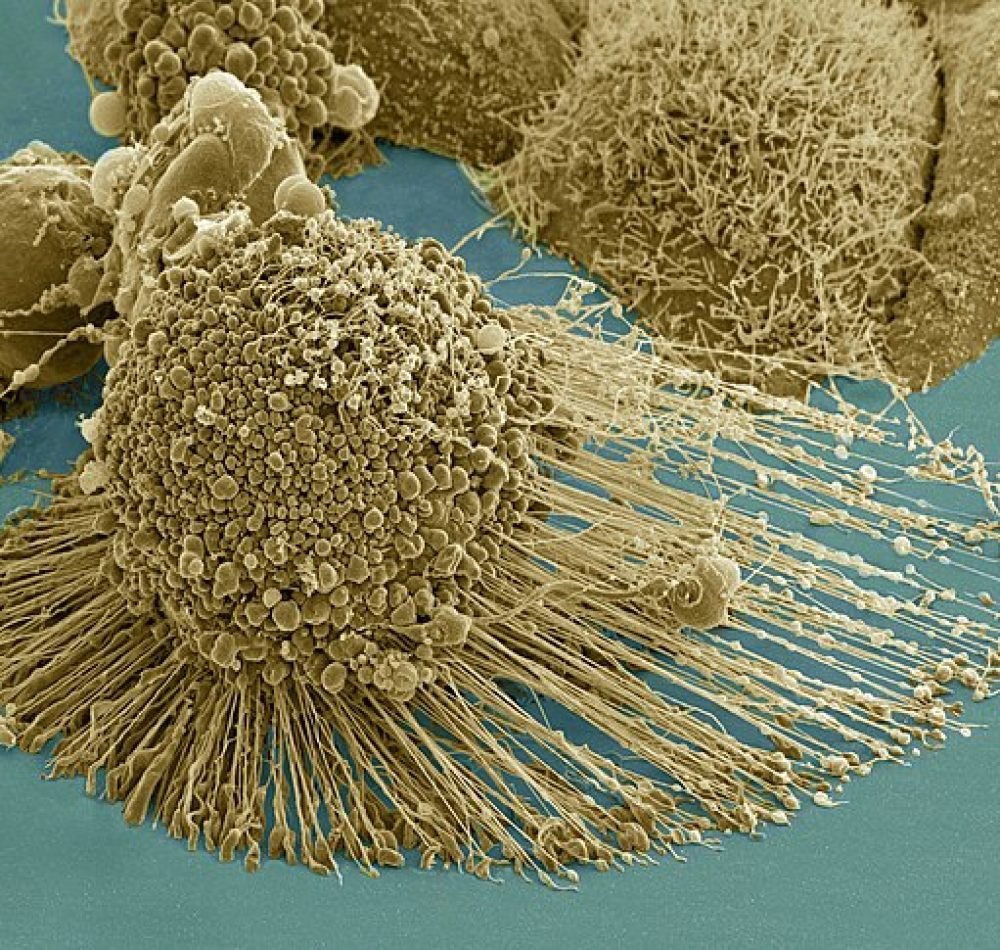Médecine : savoirs du corps, pouvoirs sur les corps
Elle sauve, elle soigne, elle rassure. Mais elle classe, elle interdit, elle surveille. La médecine, dans l’histoire, n’est jamais neutre. Elle s’inscrit dans un tissu social, politique, religieux, économique. Elle dépend d’un contexte, d’une culture, d’un régime. Ce qu’on peut faire à un corps, ce qu’on refuse de faire, ce qu’on prétend faire : tout cela dit quelque chose de l’époque.
Il n’y a pas une histoire de la médecine, mais une pluralité de récits. Celui des médecins, bien sûr, mais aussi celui des patients, des infirmières, des rebouteux, des malades oubliés. Ce que la médecine soigne n’est pas toujours une maladie : parfois, c’est un ordre à rétablir.
Médecine antique : observation ou croyance ?
En Égypte, on soigne avec des formules magiques et des instruments chirurgicaux. À Babylone, le code d’Hammurabi fixe les tarifs des soins… et les peines en cas d’échec. En Grèce, Hippocrate fonde une médecine rationnelle, basée sur l’observation clinique et l’équilibre des humeurs. Mais les temples d’Asclépios accueillent aussi des malades venus chercher un rêve guérisseur.
Chez les Romains, Galien prolonge la pensée grecque, mais l’enferme dans un système rigide. Ses écrits, copiés et traduits pendant des siècles, deviennent un dogme médical plus qu’un outil de recherche. La médecine devient une scolastique, parfois coupée du réel.
Médecine médiévale : pluralité et tensions
Dans l’Europe médiévale, la médecine est d’abord une affaire de clercs. On enseigne à Salerne, Montpellier, Bologne. On lit Avicenne, Galien, Aristote. Mais dans les campagnes, ce sont les guérisseuses, les barbiers, les apothicaires qui soignent.
Le savoir est fragmenté. On distingue les « bons » médecins — lettrés, latinisants, autorisés — des praticiens empiriques, souvent méprisés. Les femmes, souvent exclues des universités, exercent à la marge. Certaines seront accusées de sorcellerie, non parce qu’elles nuisent, mais parce qu’elles soignent en dehors du cadre.
L’Église surveille. Elle interdit certaines dissections, mais tolère des soins. La peste noire, au XIVe siècle, bouleverse tout. Les médecins sont impuissants, les malades meurent en masse, les théories volent en éclats. On accuse l’air, les juifs, les astres. La médecine devient superstition autant que science.
Renaissance et anatomie
La dissection redevient possible. Léonard de Vinci, Vésale, Ambroise Paré explorent le corps réel. Le scalpel remplace l’incantation. On commence à comprendre la circulation sanguine, les organes internes, les os. La médecine reste rudimentaire, mais elle progresse.
Mais cette avancée reste théorique. Les hôpitaux, souvent tenus par des ordres religieux, accueillent les pauvres plus qu’ils ne les soignent. Les riches se font traiter à domicile. Les saignées, les purges, les lavements demeurent les outils principaux. Le savoir avance, mais la pratique reste archaïque.
XVIIIe siècle : la médecine des Lumières
L’époque des Lumières transforme la médecine en outil de régulation sociale. L’État s’intéresse à la santé des populations. On mesure, on classe, on recense les épidémies. Les médecins deviennent des auxiliaires du pouvoir. Ils inspectent, conseillent, prescrivent.
C’est aussi le moment où la médecine devient une science de la norme. On commence à définir ce qu’est un corps « normal », une sexualité « saine », une folie « déviée ». La médecine ne soigne plus seulement : elle encadre.
Des figures comme Pinel réforment les asiles. Bichat étudie les tissus. La médecine devient expérimentale, positiviste, rationnelle. Mais dans les faits, le taux de mortalité reste élevé, les accouchements dangereux, les infections mortelles.
XIXe siècle : médecine hospitalière et coloniale
Avec la Révolution industrielle, les grandes villes deviennent des foyers d’épidémies. Le choléra, la tuberculose, la syphilis ravagent les populations ouvrières. L’État investit les hôpitaux, forme des médecins, développe une médecine sociale. Pasteur, Koch, Virchow font progresser la microbiologie.
Mais cette médecine s’exporte aussi. Dans les colonies, les médecins européens imposent leurs méthodes, souvent contre les savoirs locaux. Ils deviennent des agents du pouvoir colonial, en même temps qu’ils vaccinent, mesurent, classifient. La médecine devient un instrument de domination.
Dans les prisons, les écoles, les casernes, elle sert à discipliner les corps. On mesure les crânes, on isole les « dégénérés », on théorise les races. C’est aussi cela, l’histoire de la médecine : des dérives scientifiques déguisées en progrès.
XXe siècle : progrès, ruptures, scandales
Les deux guerres mondiales accélèrent la recherche. La médecine militaire teste des méthodes d’urgence, développe la chirurgie réparatrice, la psychiatrie de guerre. Mais elle tolère aussi des expériences inhumaines, en Allemagne nazie comme aux États-Unis.
Après 1945, les progrès sont spectaculaires : antibiotiques, anesthésie, imagerie médicale, greffes. L’espérance de vie augmente, la médecine entre dans une ère technique.
Mais les scandales surgissent. Les essais non consentis, les affaires du sang contaminé, les violences obstétricales. La médecine devient objet de débats éthiques.
La psychiatrie est remise en question. La parole du patient est réintroduite. La critique féministe dénonce le paternalisme médical. On ne soigne plus un organe, mais un être. Ou du moins, on tente.
Aujourd’hui : entre technoscience et défi social
Aujourd’hui, la médecine est à la fois triomphante et contestée. Elle dispose de moyens inédits, mais elle affronte une défiance croissante. Le Covid-19 a ravivé cette ambivalence : admiration pour les soignants, soupçon envers les autorités, fracture entre expertise et vécu.
La médecine reste un espace de pouvoir. Qui décide d’un traitement ? Qui accède aux soins ? Qui définit ce qu’est une vie « digne » ? Ces questions, loin d’être techniques, sont profondément politiques.
L’histoire de la médecine n’est pas celle d’un progrès ininterrompu. C’est celle d’une construction fragile, entre savoir, autorité, soin et domination. Une histoire qu’il faut écrire avec les médecins, mais aussi avec les soignés.