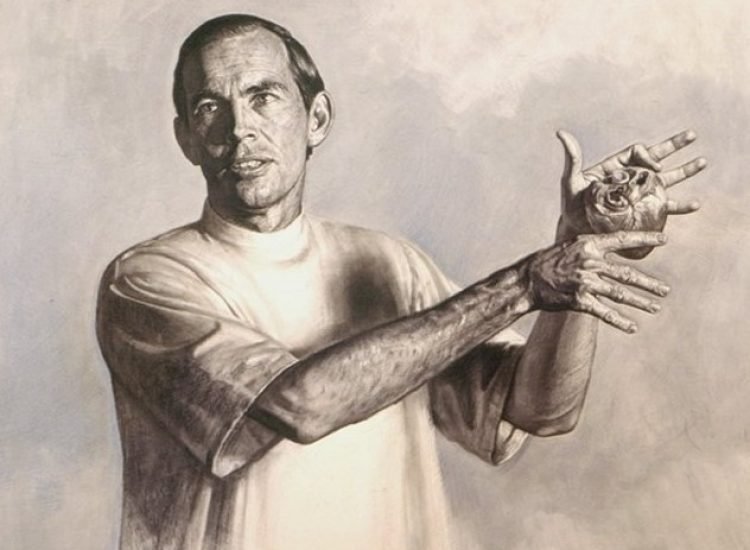Un petit cercle de taffetas noir, collé sur la joue, près des lèvres ou à la commissure de l’œil. À première vue, un caprice esthétique. À y regarder de plus près, un langage, une stratégie, une forme de pouvoir. Du XVIIe au XVIIIe siècle, la « mouche » sur le visage n’est pas seulement un artifice de coquetterie : elle participe d’un véritable système de signes, où la peau devient support d’expression.
Plus qu’un accessoire de beauté, la mouche dit ce que l’on ne dit pas. Elle affiche une humeur, un parti politique, parfois un engagement affectif. Et si elle tombe, tout s’effondre. Car dans les salons poudrés et les cours de l’Europe monarchique, le visage est un théâtre, et chaque détail compte.
Une invention française ? Pas tout à fait
On attribue souvent l’invention des mouches au raffinement français sous Louis XIV. Pourtant, leur usage précède largement le Grand Siècle. On en trouve des traces dès la fin du Moyen Âge, d’abord pour des raisons médicales : elles servaient à dissimuler les marques de petite vérole ou d’autres cicatrices. C’est à partir du XVIe siècle que la mouche devient ornement. Elle est portée aussi bien par les femmes que par certains hommes, notamment à la cour d’Henri III.
Ce n’est qu’au XVIIe siècle que leur usage explose, à la croisée de la médecine, de l’esthétique et du langage social. Leur nom même, « mouche », provient de leur forme : un point noir, comme une petite bête posée sur la peau. En réalité, il s’agit de pastilles de soie, de velours ou de taffetas, parfois découpées en forme de lune, d’étoile ou de cœur.
Une grammaire du visage
Au XVIIIe siècle, la mouche se codifie. Elle ne se pose pas n’importe où. Chaque emplacement porte une signification précise, connue des courtisans et courtisanes comme un alphabet discret. En voici quelques exemples, issus des traités de l’époque :
- Sur le coin de la bouche : la coquette
- Sur le menton : la discrète
- Près de l’œil droit : la passionnée
- Au-dessus du sourcil : la majestueuse
- Sur le nez : l’effrontée
- À la tempe : la rêveuse
Ce lexique corporel, enseigné dans les manuels de maintien, permet d’émettre des signaux en société, sans prononcer un mot. Un simple regard posé sur une mouche peut révéler une intention, une humeur, un refus ou une provocation. La mouche devient ainsi une arme sociale, dans un monde où tout est signe et apparence.
La politique sur la peau
Au-delà des jeux de séduction, les mouches ont aussi servi de marqueurs politiques. Pendant les périodes de tension entre factions à la cour, notamment sous la Régence, certaines femmes portaient leurs mouches du côté gauche ou droit du visage selon leur loyauté.
La « mouche gauche » pouvait ainsi signifier une fidélité aux Orléans, tandis que la « mouche droite » renvoyait au parti du roi. Dans certains cas, leur présence ou leur absence pouvait même servir d’indice dans les cercles d’espionnage aristocratique. Une simple mouche, posée de façon ostentatoire, pouvait trahir un ralliement ou une trahison.
Une esthétique de la dissimulation
Il serait erroné de penser que la mouche n’était qu’un simple jeu codé. Elle répond à un besoin profond de contrôle du corps, dans une société où le naturel est suspect. Le visage ne doit rien laisser paraître de vulgaire, ni de véritablement spontané. On poudre, on farde, on recouvre, on maquille.
Les mouches permettent alors de détourner l’attention. Une cicatrice, une rougeur, un bouton : tout peut être gommé symboliquement sous un point noir soigneusement placé. C’est une manière de faire du défaut un artifice, de transformer la gêne en langage.
Certaines femmes, atteintes de variole ou marquées par la maladie, pouvaient en porter jusqu’à dix ou douze à la fois. À l’excès, cela pouvait même devenir ridicule, et certains pamphlets du XVIIIe siècle se moquent des visages parsemés comme des cartes d’astronomie.
La mouche comme luxe
Plus qu’un simple bout de tissu, la mouche devient parfois un objet de luxe. Certaines sont découpées à la main, incrustées de fils d’or ou d’argent, présentées dans de petites boîtes à mouches, elles-mêmes richement décorées. Ces étuis, souvent offerts en cadeau galant, témoignent du soin apporté à ces éléments minuscules.

Dans les correspondances privées, offrir une boîte à mouches est un geste ambigu : c’est flatter l’esthétique de l’autre, mais aussi l’inviter à s’exprimer par le visage. En cela, la mouche s’inscrit dans l’économie du paraître, mais aussi du lien social. Elle est ce qui permet d’initier la conversation sans mots.
Un retour discret sous la Révolution
Avec la chute de l’Ancien Régime, les mouches disparaissent des visages. Jugées aristocratiques, frivoles, inutiles, elles sont abandonnées avec les perruques et les corsets. Mais dans les cercles royalistes clandestins, certaines femmes continuent d’en porter une, discrète, comme un clin d’œil nostalgique, un acte de résistance esthétique.
La littérature post-révolutionnaire en garde la trace. Chateaubriand évoque dans ses Mémoires d’outre-tombe une femme « dont la bouche marquait la grâce par un point de velours ». C’est peu dire, mais c’est assez pour rappeler que même dans le silence de la Terreur, le visage pouvait encore parler.
Héritages contemporains
On croit la mouche oubliée, mais elle revient parfois dans la mode, le théâtre ou la haute couture. Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood, ou Dior s’en sont inspirés dans leurs défilés. Dans certains ballets ou opéras, on les revoit collées sur les visages poudrés, comme un clin d’œil savant à l’étiquette disparue.
Le cinéma en a aussi fait un symbole. Dans Barry Lyndon de Kubrick, dans Marie-Antoinette de Coppola, ou dans des pastiches plus contemporains, la mouche évoque immédiatement un monde d’apparences, de subtilités, de tension entre nature et artifice.
Et aujourd’hui encore, un grain de beauté maquillé, un point noir volontaire, peut prolonger l’héritage invisible de ce code ancien, que seuls les plus attentifs savent lire.
Quelques liens et sources utiles
Marc-Alain Descamps, Le Langage du corps et la communication corporelle, Presses universitaires de France, 1993
Antoine Le Camus, Abdeker ou l’Art de conserver la beauté, vol. 1, Libr. associés, 1774