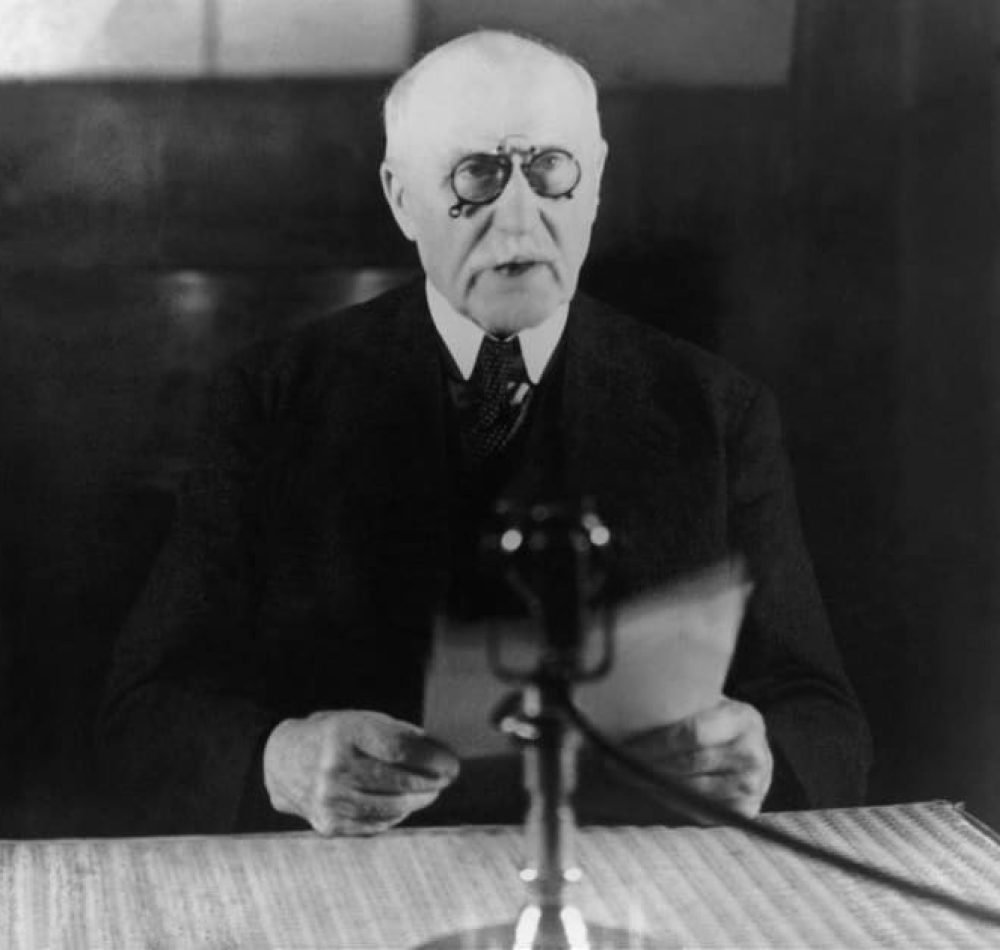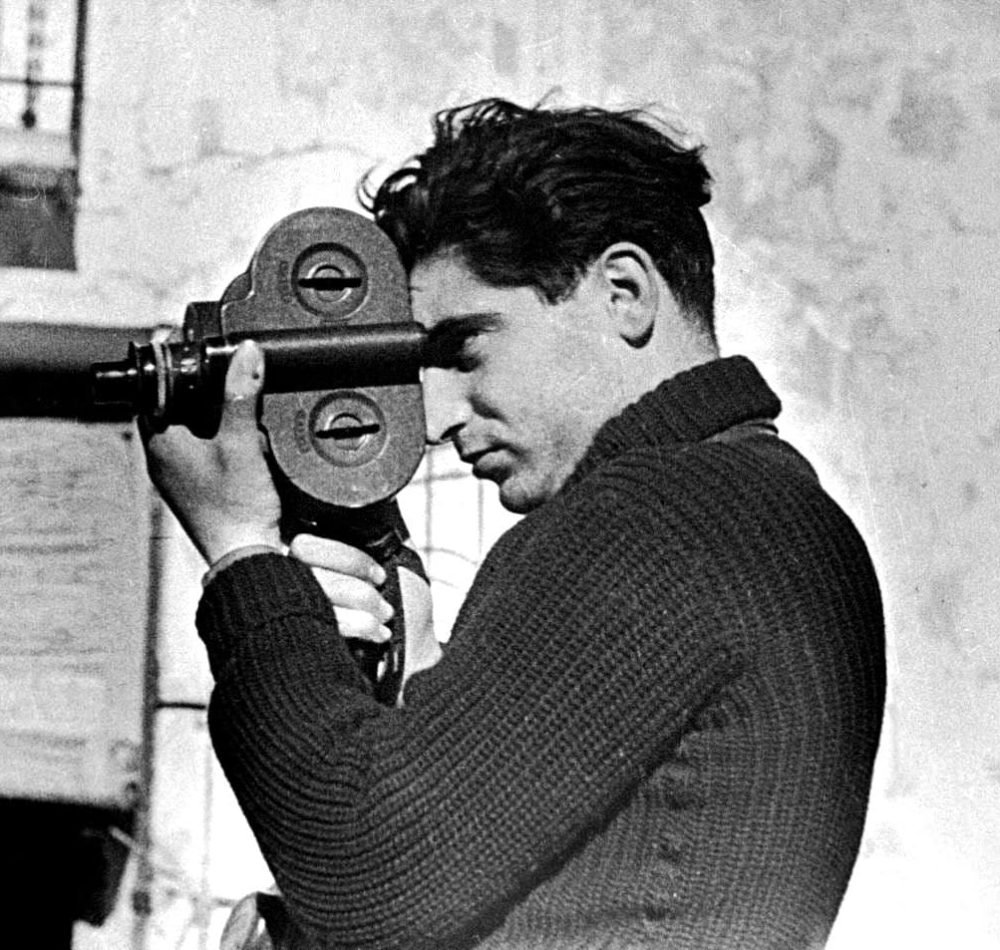Seconde Guerre mondiale : empires effondrés, sociétés retournées, mémoire en tension
Elle fut plus qu’un conflit. Elle fut un basculement du monde. Entre 1939 et 1945, plus de 60 millions de morts. Des continents entiers bouleversés, des régimes détruits, des sociétés retournées. Elle fut une guerre idéologique, une guerre industrielle, une guerre d’extermination. Elle n’a pas opposé deux armées, mais deux visions du monde. Et elle a laissé des traces qui, aujourd’hui encore, structurent le présent.
Mais derrière les batailles connues, les figures héroïques ou les récits nationaux, la Seconde Guerre mondiale est d’abord une guerre vécue. Une guerre fragmentée, aux temporalités multiples, aux expériences contradictoires. On ne la vit pas de la même manière à Berlin, à Varsovie, à Oran, à Saïgon, à Shanghai ou à Paris.
Une guerre commencée plus tôt
L’histoire officielle commence en septembre 1939, avec l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie. Mais la guerre a déjà commencé ailleurs. En 1937, le Japon envahit la Chine. En 1936, l’Allemagne a remilitarisé la Rhénanie. En 1938, l’Anschluss a annexé l’Autriche. En 1939, le pacte germano-soviétique donne à Hitler la liberté d’agir à l’Est.
La « drôle de guerre » en France masque mal l’inéluctable. En mai 1940, la Wehrmacht lance la Blitzkrieg. La France s’effondre en six semaines. Pétain signe l’armistice. L’Europe occidentale devient un terrain d’occupation, de collaboration, de résistance.
Une guerre mondiale, dans tous les sens du mot
L’Allemagne occupe la majeure partie de l’Europe. L’Italie fasciste tente de suivre. Le Japon s’étend dans le Pacifique. Les Alliés s’organisent : le Royaume-Uni, puis l’URSS (après juin 1941), les États-Unis (après décembre 1941). La guerre devient planétaire.
Mais elle n’est pas qu’une série d’affrontements militaires. Elle transforme l’économie, les rapports de genre, les structures sociales. Elle mobilise tout. Les usines produisent des chars, les femmes remplacent les hommes, les enfants collectent le métal, les scientifiques inventent l’arme nucléaire.
Les colonies sont enrôlées. Des tirailleurs africains, des soldats maghrébins, des Indochinois, des Malgaches sont envoyés au front ou dans les bases arrière. Leur rôle est crucial, mais souvent nié dans les mémoires nationales.
Guerre d’extermination
La Seconde Guerre mondiale est la matrice de la Shoah. L’entreprise d’extermination des Juifs d’Europe ne relève pas de la « folie » ou de l’ »excès », mais d’un projet rationnel, planifié, bureaucratique. Ghettos, rafles, convois, camps : tout est pensé pour déshumaniser, isoler, éliminer.
6 millions de Juifs, mais aussi des Tsiganes, des homosexuels, des handicapés, des opposants politiques. La machine de mort dépasse l’entendement. Auschwitz devient un nom connu, mais il ne résume pas tout. Il y a aussi Treblinka, Sobibor, Majdanek. Et les fusillades de masse en Ukraine, en Lituanie, en Biélorussie. Des milliers de fosses communes, sans nom.
Collaboration, résistance, attentisme
En France, le régime de Vichy s’installe. L’État français collabore activement. Il promulgue ses propres lois antisémites, déporte, surveille, condamne. La ligne de démarcation n’est pas seulement géographique. Elle traverse les familles, les esprits, les engagements.
La Résistance s’organise lentement. Il faut du temps pour qu’elle prenne forme, qu’elle se coordonne. Communistes, gaullistes, socialistes, anarchistes, réseaux chrétiens : le front commun n’existe pas au départ. Mais à mesure que l’occupant durcit sa répression, que les combats se rapprochent, que les massacres se multiplient, la Résistance s’intensifie.
Elle prend des formes multiples : sabotage, renseignement, propagande, guérilla. Elle coûte cher. Arrestations, tortures, exécutions. Et souvent, l’anonymat. Car la mémoire officielle n’a pas gardé tous les noms.
Fronts multiples, stratégies croisées
Le front de l’Est est le cœur de la guerre. L’URSS encaisse des pertes inouïes : plus de 20 millions de morts. Les batailles de Stalingrad (1942-43) et de Koursk (1943) marquent le tournant. Le Reich commence à reculer. Mais la violence ne faiblit pas. Les civils sont exécutés, les villes rasées, les prisonniers affamés.
Dans le Pacifique, les batailles sont d’une intensité extrême : Midway, Guadalcanal, Iwo Jima. Le Japon refuse la reddition. La guerre devient une course à l’épuisement. En août 1945, Hiroshima et Nagasaki sont détruites par la bombe atomique. Le monde entre dans l’ère nucléaire.
Libérations et épurations
En 1944, les Alliés débarquent en Normandie. La France est progressivement libérée. Mais la libération n’est pas l’euphorie simple que l’on raconte parfois. Elle est ambivalente. Les résistants réclament justice. Les règlements de compte prolifèrent. Les femmes tondues, les suspects arrêtés, les procès expéditifs : l’épuration sauvage précède l’épuration judiciaire.
La reconstruction de l’autorité passe par un récit cohérent : celui d’un peuple uni derrière la Résistance. Il masque les divisions, les passivités, les complicités. Il efface aussi les étrangers de la Résistance, les soldats coloniaux, les femmes de l’ombre.
Mémoires conflictuelles
Après 1945, l’heure est au deuil. Mais la mémoire reste politique. En URSS, on glorifie la « Grande Guerre patriotique ». En France, on célèbre la Résistance, puis on redécouvre la collaboration. En Allemagne, on impose le silence, puis on déconstruit les mythes.
Chaque pays reconstruit son identité autour de cette guerre. Mais les mémoires s’entrechoquent. Les procès de Nuremberg, les témoignages des survivants, les récits de guerre, les films, les manuels : tout devient terrain d’interprétation.
La Shoah, longtemps marginalisée, devient centrale dans les années 1980-90. Les témoins parlent. Les négationnistes aussi. La mémoire devient un combat.
Une guerre encore active
La Seconde Guerre mondiale n’est pas close. Ses traces sont encore là. Les frontières qu’elle a dessinées. Les traités qu’elle a inspirés. Les institutions qu’elle a fait naître : ONU, Europe, OTAN. Elle a fixé le rapport au mal absolu, à la violence légitime, à la responsabilité historique.
Mais elle n’est pas une leçon simple. Elle n’offre pas de morale définitive. Elle montre la banalité de la barbarie, la plasticité de l’obéissance, l’ampleur des silences. Elle rappelle que l’histoire n’est pas un bloc, mais un empilement d’expériences contradictoires.




![Quelques membres du Commando Kieffer – Kieffer92 [Pseudo Wikipédia] | Creative Commons BY-SA 4.0 Quelques membres du Commando Kieffer - Kieffer92 [Pseudo Wikipédia] | Creative Commons BY-SA 4.0](https://revue-histoire.fr/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Quelques-membres-du-Commando-Kieffer-qr5danaai48cysvx07386sh88hxuqrla7nyankaj30.png)