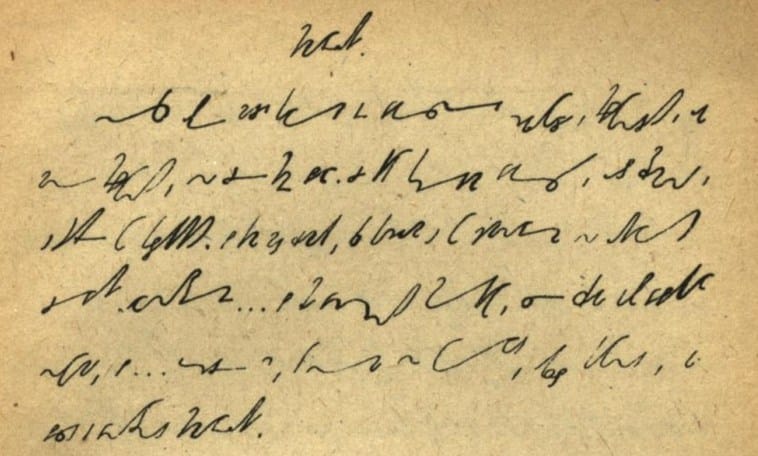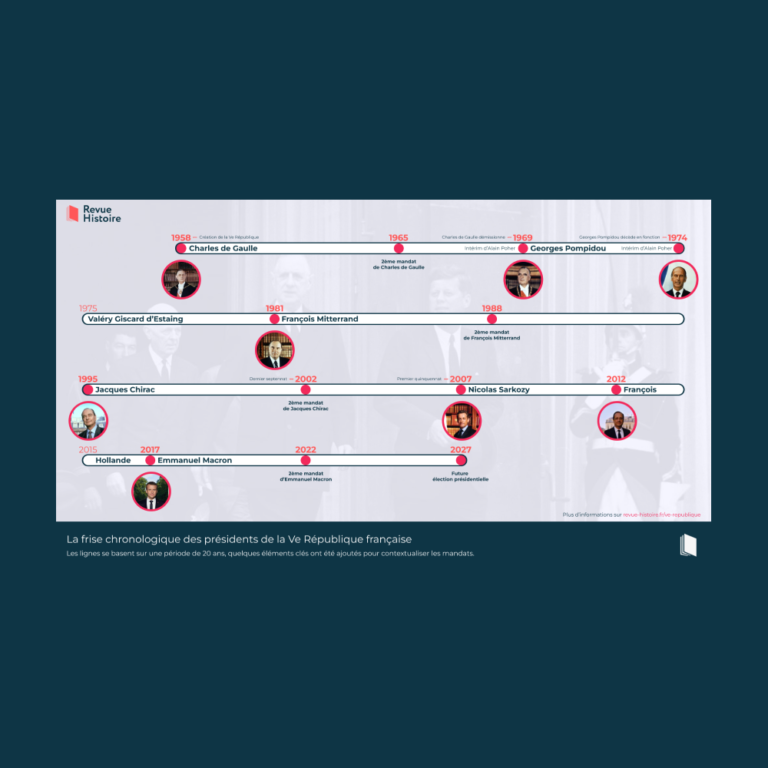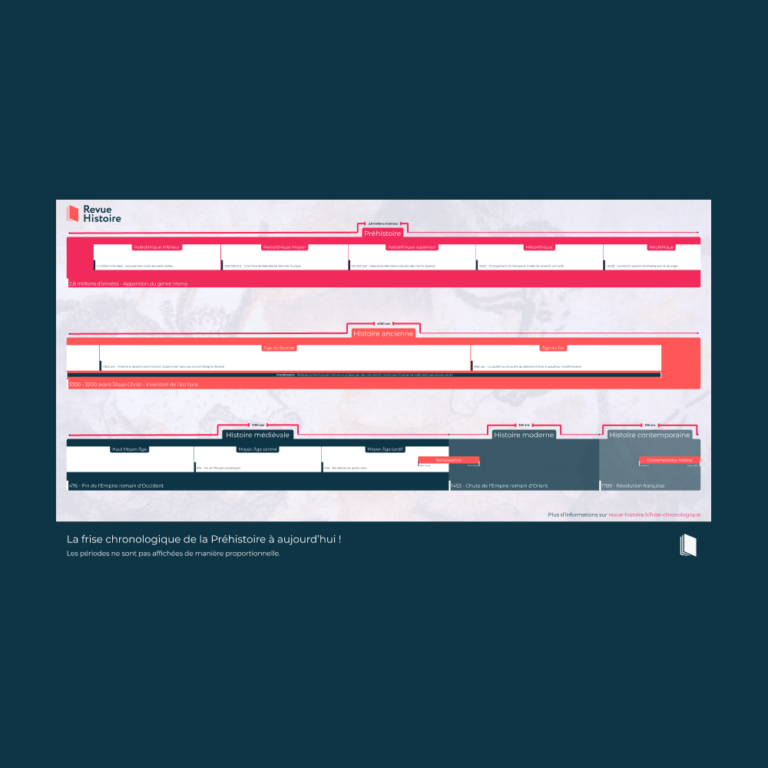Une introduction en histoire efficace installe le sujet, fixe l’angle et prépare la démonstration. Elle doit cadrer les notions, poser une problématique claire et annoncer un plan lisible, sans lourdeur.
Cet article propose une méthode opérationnelle pour rédiger une entrée en matière précise, fluide et adaptée aux attentes universitaires. Vous y trouverez des repères concrets, des exemples d’énoncés et des conseils de style pour gagner en clarté dès la première page.
Comprendre le rôle de l’introduction
L’introduction oriente la lecture : elle transforme un thème en question, situe le cadre et engage la démonstration à venir.
Cadrer le sujet et définir les notions
Commencez par clarifier le sujet : quelles notions recouvre-t-il, quelles limites spatiales et chronologiques retient-il, quels acteurs met-il en jeu ? Définir précisément deux ou trois termes clés stabilise le vocabulaire et évite le hors-sujet. Annoncez les bornes de façon motivée, en montrant ce qu’elles incluent et ce qu’elles laissent de côté. Ce cadrage, concis mais ferme, prépare l’interrogation centrale et facilite la sélection d’exemples pertinents.
Poser la problématique et l’enjeu
La problématique est une question ouverte qui met en tension mécanismes et limites. Elle n’est ni un titre, ni un thème : elle oriente un raisonnement. Formulez-la en explicitant l’enjeu historique (continuités et ruptures, échelles, acteurs). Testez sa faisabilité : avez-vous matière à deux ou trois arguments étayés ?
Une problématique opérationnelle appelle naturellement un plan cohérent et donne sa direction à l’ensemble du devoir.
Annoncer l’angle adopté
Précisez l’angle retenu : comparaison, étude de dynamique, analyse d’acteurs ou de politiques publiques. Cette indication situe la perspective sans dévoiler la totalité du contenu. Elle aide le lecteur à comprendre pourquoi certains aspects sont privilégiés. L’angle s’accorde au corpus et au niveau d’exigence : mieux vaut une approche claire et maîtrisée qu’une promesse trop large qui disperserait l’argumentation.
Construire une introduction en quatre mouvements
Quatre temps structurent l’entrée en matière : accroche, définitions et cadre, problématique, annonce du plan.
Forger une accroche pertinente
L’accroche met en situation sans digression. Évitez les généralités et les anecdotes déconnectées. Préférez un fait bref, un repère chronologique net ou une opposition significative. En quelques lignes, créez l’attente et ouvrez vers la question centrale. Une bonne accroche ne remplace pas le cadrage : elle le prépare et s’efface ensuite pour laisser place à la définition précise des termes et à l’établissement des bornes de l’étude.
Définir et cadrer avec précision
Exposez les définitions utiles, fixez l’espace et le temps, nommez les acteurs. Deux ou trois phrases suffisent si elles sont exactes et motivées. Bannissez les listes encyclopédiques : gardez l’essentiel lié à la future démonstration. Ce passage sert de pivot entre l’accroche et la problématique ; il assure que tous les termes seront compris dans le même sens au fil du devoir, ce qui évite les malentendus d’interprétation.
Poser la question et annoncer le plan
Formulez la problématique en une phrase claire, puis annoncez un plan en deux ou trois mouvements. Utilisez des termes directeurs plutôt que de dévoiler des intitulés longs. L’annonce doit refléter une progression argumentative, non une simple juxtaposition de thèmes. Elle engage la lecture et fixe une attente de démonstration. Veillez à ce que le plan promis soit strictement respecté dans le développement.
Style, cohérence et erreurs à éviter
Clarté, concision et rigueur formelle donnent à l’introduction sa force persuasive.
Assurer unité et lisibilité
Visez des phrases nettes, un lexique stable et des repères chronologiques homogènes. Évitez les ruptures de temps, les parenthèses lourdes et les citations longues dès l’entrée. Cherchez la continuité : chaque phrase prépare la suivante. Relisez l’introduction isolément : comprend-on l’objet, l’angle, la question et l’architecture sans ambiguïté ? Cette lisibilité initiale conditionne la réception de la démonstration.
Écarter les pièges récurrents
Évitez l’introduction « catalogue » qui accumule définitions et dates sans orientation. Fuyez les problématiques vagues, les généralités morales et les promesses démesurées. N’annoncez pas un plan qui ne répond pas à la question. Enfin, ne confondez pas accroche et développement : l’entrée en matière ouvre le sujet, elle ne le traite pas. Cette discipline protège le cœur de la copie et crédibilise votre approche.
Quelques idées de sujets pour s’entraîner
Haussmann et la transformation de Paris (1853-1870)
- À cadrer : « modernisation urbaine », « hygiénisme », « contrôle social », acteurs (préfet, municipalité, propriétaires, classes populaires).
- Bornes : Second Empire (décret de 1853 → chute de 1870).
- Accroche possible : ouverture du boulevard Sébastopol (1858) comme vitrine du nouveau Paris.
- Problématique (exemple) : En quoi les travaux haussmanniens redéfinissent-ils à la fois l’efficacité urbaine et les rapports sociaux dans la capitale entre 1853 et 1870 ?
- Pistes de plan :
I. Logiques et instruments de la modernisation (voirie, réseaux, finances)
II. Effets sociaux et spatiaux (embourgeoisement, déplacements, résistances)
III. Héritages et limites (durabilité, critiques, inachevés)
La crise de Suez (1956) : tournant géopolitique ?
- À cadrer : « nationalisation », « équilibres de la Guerre froide », « décolonisation ».
- Bornes : 26 juillet – novembre 1956, avec un bref recul (accords de 1888 sur le canal) et les suites onusiennes début 1957.
- Accroche possible : annonce de Nasser à Alexandrie (26/07/1956).
- Problématique (exemple) : En quoi Suez marque-t-il la recomposition des hiérarchies de puissance, du vieux bilatéralisme impérial à l’arbitrage américano-soviétique ?
- Pistes de plan :
I. Les ressorts de l’affrontement (intérêts, acteurs, droit)
II. Le déroulement et l’échec politico-militaire franco-britannique
III. Les effets systémiques (ONU, image des puissances, décolonisation)
Les questions qu’on se pose sur introduction en histoire
Faut-il une accroche dans tous les cas ?
Oui, si elle sert le sujet. Une accroche courte et pertinente installe un repère ou une tension utile. Elle n’est ni obligatoire ni efficace si elle est gratuite. Priorité au cadrage précis et à la question centrale : mieux vaut une entrée sobre qu’une anecdote qui brouille la lecture dès les premières lignes.
Où placer les définitions et les bornes temporelles ?
Juste après l’accroche, avant la problématique. Deux ou trois phrases suffisent pour définir les notions clés et fixer l’espace-temps. Expliquez brièvement vos choix afin de montrer leur pertinence. Ce passage garantit que le développement reposera sur des termes partagés et un périmètre d’analyse clairement assumé.
Comment formuler la problématique sans alourdir ?
Une phrase claire, orientée par un enjeu précis, suffit. Évitez les questions multiples et les formules vagues. Testez-la : permet-elle une démonstration en deux ou trois mouvements ? Si oui, annoncez immédiatement un plan cohérent. Si non, affinez l’angle, réduisez l’échelle ou précisez les acteurs pour gagner en pertinence.
L’annonce du plan doit-elle détailler les parties ?
Non. Contentez-vous de mots directeurs qui indiquent la progression. L’annonce n’est pas un sommaire détaillé. Elle sert de promesse lisible et engage la structure du développement. C’est dans le corps du devoir que l’on déploie les intitulés complets et les arguments.
Les points clés à retenir
- Clarifier le sujet, définir deux ou trois notions et fixer des bornes motivées.
- Formuler une problématique faisable et orientée vers la démonstration.
- Construire l’introduction en quatre mouvements enchaînés.
- Annoncer un plan court, cohérent et strictement respecté ensuite.
- Soigner lisibilité, unité de ton et précision du lexique dès la première page.
Quelques liens et sources utiles
Yannick Clavé, Méthodologie de la dissertation en histoire : Classes préparatoires, licence, concours, Ellipses, 2021
Pierre Saly, François Hincker, Marie-Claude L’Huillier, Jean-Paul Scot, Michel Zimmermann, Le commentaire de documents en histoire – 3ED NP, Armand Colin, 2017
Pierre Saly, François Hincker, Marie-Claude L’Huillier, Jean-Paul Scot, Michel Zimmermann, La dissertation en histoire, Armand Colin, 2019