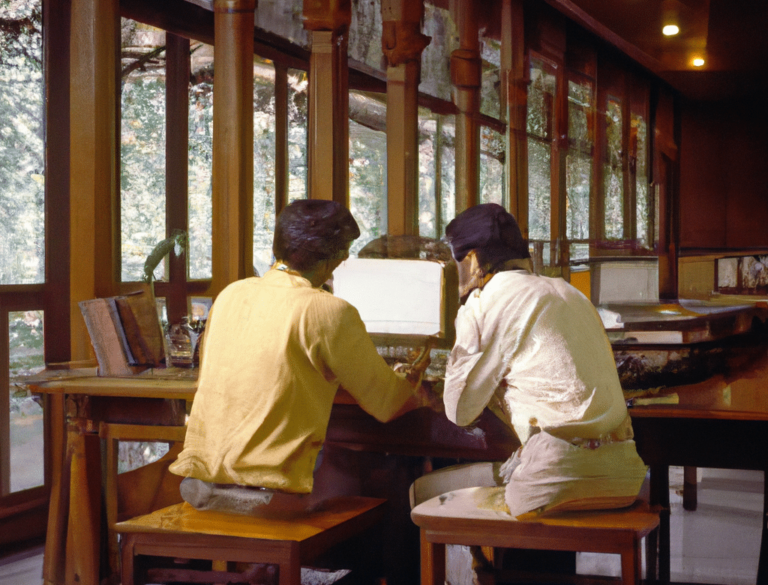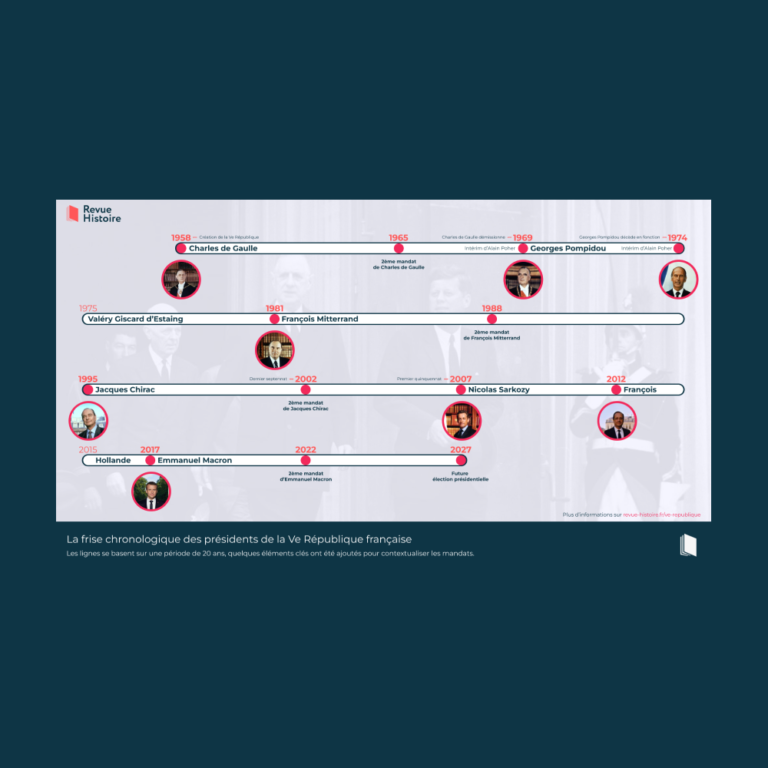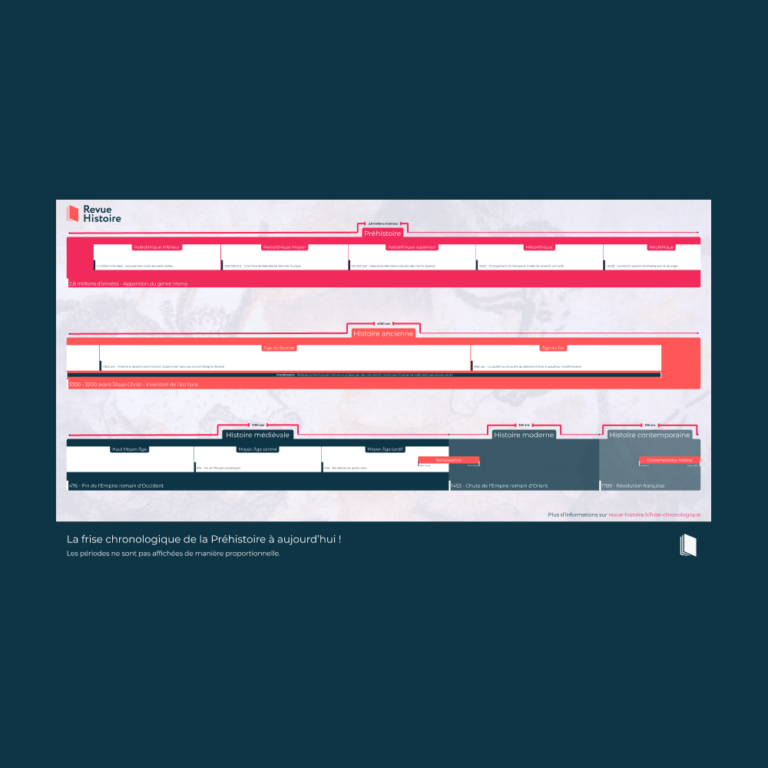L’introduction de mémoire installe le sujet, cadre l’enquête et annonce la démonstration. Elle doit définir des notions précises, poser une problématique faisable, situer l’apport dans l’historiographie et présenter un plan cohérent. L’objectif est de guider le lecteur avec une promesse claire : quels mécanismes seront étudiés, avec quels matériaux, selon quelles méthodes, et au service de quelle réponse. Une introduction réussie donne envie de poursuivre tout en fixant des attentes vérifiables.
Poser le cadre scientifique dès l’ouverture
Délimiter le périmètre de l’étude, expliciter la question et montrer l’intérêt scientifique du travail.
Clarifier le sujet et les bornes
Présentez le sujet en une phrase nette, puis justifiez l’espace, la période et les acteurs retenus. Expliquez ce que le cadrage inclut et exclut pour éviter le hors-sujet. Définissez deux ou trois notions indispensables et stabilisez le vocabulaire. Ce périmètre sert de fil directeur : il sélectionne les sources pertinentes, oriente la collecte des exemples et prépare l’architecture de preuve. Un cadrage précis rend possible une démonstration resserrée et cumulative.
Formuler la problématique et les hypothèses
Transformez le thème en question ouverte qui met en tension mécanismes et limites. Énoncez une hypothèse principale (et, si besoin, des hypothèses secondaires) que le corpus pourra éprouver. La problématique doit être faisable au regard du temps et des matériaux ; elle appelle un plan en deux ou trois mouvements. Rédigez une phrase-thèse provisoire : elle guidera l’ordonnancement des chapitres et facilitera l’évaluation de la cohérence tout au long de l’écriture.
Situer l’apport dans l’historiographie
Identifiez brièvement deux ou trois travaux de référence, un débat utile et l’angle qui fera progresser la discussion. Positionnez votre contribution : clarification, comparaison, réexamen d’un cas, changement d’échelle. Evitez la bibliographie catalogue ; privilégiez des références qui outillent la démonstration. Cette mise en perspective montre que l’étude n’est pas isolée et que vos résultats dialogueront avec des thèses existantes, sans se confondre avec elles.
Construire une introduction en quatre mouvements
Accroche, définitions et cadre, problématique, annonce du plan : une progression lisible et sans redite.
Accroche pertinente et contextualisation
Ouvrez par un repère précis (fait bref, contraste, donnée), immédiatement rattaché au sujet. Écartez les généralités et les anecdotes gratuites. En quelques lignes, installez le contexte utile à la compréhension de la question. L’accroche prépare le cadrage ; elle ne le remplace pas. Son rôle est d’orienter le regard du lecteur vers l’angle retenu, afin que la suite apparaisse nécessaire et non décorative.
Définitions, corpus et terrain
Définissez les notions clés puis présentez, en une phrase claire, le corpus ou le terrain : types de sources, période couverte, accès. Indiquez l’élément décisif qui rend l’enquête possible (fonds, série continue, inventaire). Cette transparence méthodologique dès l’introduction prépare la confiance et évite les malentendus. Elle explique aussi pourquoi certaines preuves seront centrales et d’autres marginales dans la démonstration à venir.
Annonce du plan et des méthodes
Formulez la problématique en une phrase, puis annoncez un plan court en deux ou trois mouvements. Employez des mots directeurs qui signalent la progression (genèse, inflexions, effets), pas des intitulés encyclopédiques. Si une méthode structure la preuve (sériation, cartographie, prosopographie), annoncez-la brièvement. Le lecteur doit comprendre comment la réponse sera construite et selon quel enchaînement d’arguments, sans découvrir une architecture différente au fil du texte.
Style, cohérence et bonnes pratiques
Veiller à la lisibilité, à l’alignement avec le corps du mémoire et à la rigueur des références.
Clarté, ton et lisibilité
Écrivez des phrases claires, avec un lexique précis et des connecteurs logiques. Évitez les parenthèses lourdes et les citations longues dès l’entrée. Harmonisez dates, unités et noms propres. Le ton est institutionnel sans rigidité : il s’agit d’installer une autorité calme. Relisez l’introduction isolément : comprend-on l’objet, l’angle, la question et l’architecture sans ambiguïté ? Corrigez ce qui brouille cette perception.
Longueur, citations et éthique
Restez sobre : une à trois pages selon les usages du département. Citez peu, mais utile, et normalisez d’emblée le style bibliographique. Mentionnez toute contrainte méthodologique majeure (anonymisation, accès aux fonds) qui conditionnera les résultats. N’annoncez pas ce que vous ne pourrez pas démontrer. La sincérité méthodologique dès l’introduction protège la crédibilité du travail et prépare une discussion finale solide.
Révisions et alignement avec la suite
Mettez à jour l’introduction au fil de l’avancée : ajustez problématique, périmètre et annonce de plan si la preuve l’exige. Toute révision doit améliorer la cohérence entre promesse initiale et résultats. Vérifiez l’accord strict entre l’annonce des parties, les titres de chapitres et la conclusion générale. Un alignement soigné facilite la lecture du jury et renforce l’évidence de la démonstration.
Les questions qu’on se pose sur introduction de mémoire
Quelle place donner à l’historiographie dans l’introduction ?
Présentez deux ou trois références décisives et le débat utile à votre angle. Le détail ira dans l’état de l’art ou dans les chapitres. L’introduction doit montrer la pertinence de votre positionnement, pas tout l’inventaire bibliographique. Sélectionnez ce qui éclaire la question et justifie votre contribution.
Faut-il annoncer les méthodes dès l’introduction ?
Oui, si elles structurent la preuve. Mentionnez brièvement la méthode dominante (ex. sériation, analyse iconographique) et renvoyez au chapitre concerné pour le détail. Le lecteur doit comprendre comment la réponse sera construite. Inutile d’entrer dans le protocole complet à ce stade.
Quelle longueur viser pour l’introduction ?
En général, une à trois pages suffisent : assez pour cadrer, problématiser et annoncer le plan ; pas assez pour épuiser le sujet. Si vous avez besoin de plus, c’est souvent que des éléments méthodologiques ou historiographiques basculent mieux dans des sections dédiées.
Peut-on reformuler la problématique après dépouillement ?
Oui, si la cohérence s’améliore. Actualisez alors l’introduction, l’annonce de plan et, le cas échéant, la conclusion. Notez brièvement la modification pour en garder la traçabilité. L’enjeu est de rester fidèle aux preuves, pas à une version initiale devenue inexacte.
Les points clés à retenir
- Cadrer le sujet, les bornes et les notions dès l’ouverture.
- Problématiser en une question faisable et féconde.
- Annoncer un plan court, aligné sur la logique de preuve.
- Positionner l’apport dans l’historiographie sans catalogue.
- Relire pour la clarté, l’éthique et l’alignement avec la suite.
Quelques liens et sources utiles
Vassili Joannidès de Lautour, Méthodologie du mémoire de fin d’études et de la thèse professionnelle, ELLIPSES, 2017
Sophie Boutillier, Nelly Labère, Alban Goguel d’Allondas, Dimitri Uzunidis, Méthodologie de la thèse et du mémoire, STUDYRAMA, 2022
Salvatore Marteddu, Outils et méthodologie de mémoires de recherche et/ou à visée professionnelle en sciences humaines et sociales, CAFEURIS, 2022