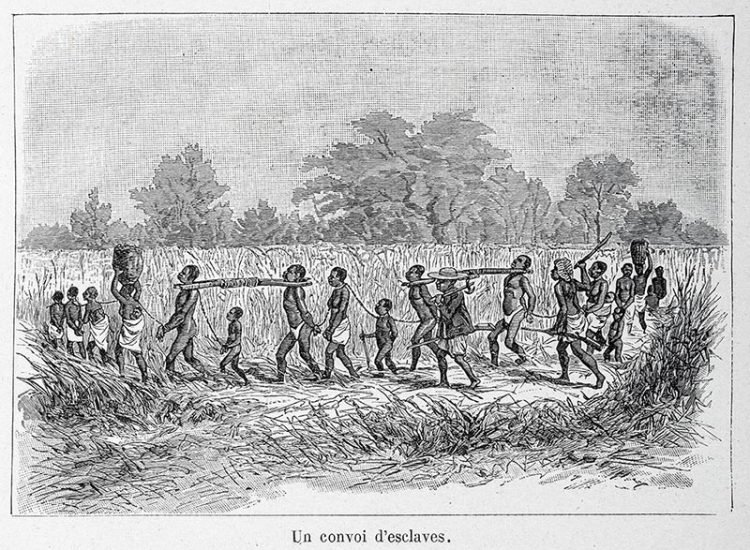Après la guerre de libération suédoise, la Suède devint indépendante sous la direction de Gustav Vasa. Le Danemark, qui avait perdu le contrôle de ce territoire, était alors dirigé par Frédéric Ier, oncle de Christian II, destitué en 1523. Les deux nouveaux souverains ne cherchaient pas nécessairement un conflit, mais les tensions restaient vives.
En 1533, la mort de Frédéric Ier permit à son fils, Christian III, de prendre sa place, qui , mit les armes de la Suède dans ses armoiries, revendiquant ainsi le territoire de Gustav Vasa. Néanmoins, aucun conflit ne se déclenche sous son règne, ce qui se reflète avec le traité de Brömsebro qui fut signé en 1541, scellant une alliance dano-suédoise contre la Ligue hanséatique, qui par ses intérêts ne reste pas neutre dans les conflits. Toutefois, avec l’avènement de Frédéric II sur le trône danois, les ambitions grandirent.
En effet, en 1559, la guerre de Livonie, entamée l’année précédente, s’intègre à la série de conflits qui marquèrent la fin du XVIe siècle, et cette même année, le Danemark acquit l’île d’Ösel (Saaremaa) et le Wiek, menaçant directement la Suède. Celle-ci, déjà coupée de l’Atlantique par la Norvège sous domination danoise, voyait sa position en mer Baltique de plus en plus précaire.
La mort de Gustav Vasa en 1560 accélérait de ce fait cette dynamique de déstabilisation, puisque son fils, Éric XIV, s’engage dans une politique ambitieuse.
Les puissances du Nord pour le contrôle de la mer Baltique
L’accession au trône d’Éric XIV en 1560 marque un tournant dans la politique suédoise, en effet contrairement à son père, Gustav Vasa, qui avait consolidé le royaume après l’indépendance, il se montre plus ambitieux. Cette homme, qui est récemment arrivé au pouvoir, cherche à affaiblir l’influence danoise dans la région et à renforcer la présence suédoise en mer Baltique.
Cette politique inquiète ses voisins, en particulier le Danemark et la Pologne-Lituanie, qui redoutent une montée en puissance de cette couronne devenue indépendante. C’est dans ce climat de méfiance croissante que vont émerger les tensions conduisant au conflit.
Dès 1561, Éric XIV parvint à obtenir l’allégeance de la ville de Reval et de ses environs en confirmant les privilèges de la noblesse locale, en outre cela l’amène à limiter les libertés commerciales des villes hanséatiques en Suède, n’accordant ces privilèges qu’à Lübeck, Dantzig, Stralsund et Hambourg. Il impose par ailleurs des restrictions sur le commerce avec la Russie.
Mais la Pologne qui souhaitait avoir une place dans le commerce, ne pouvait pas rester neutre dans ces luttes. C’est dans cette continuité que Sigismond II Auguste, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, s’inquiète, des ambitions suédoises en mer Baltique, tout en ayant peur que les Suédois annexent dans le futur la Livonie, menaçant ainsi les principautés allemandes.
Une politique d’alliance se mit alors en place, les ducs de Prusse, de Poméranie, de Mecklembourg, de Brandebourg et de Lübeck sont sollicités pour fournir un soutien militaire et financier au Danemark. Lübeck, dont le commerce maritime était en danger, rejoignit rapidement cette alliance et incita les Danois à la guerre.
Frédéric II du Danemark, exaspéré par ces mesures, estime qu’il est impossible d’entretenir de bonnes relations avec la Suède et exige donc l’arrêt du commerce suédois à Narva.
Dans l’escalade des tensions, ce qui fit déborder le vase, fut l’action d’Éric XIV qui, prit les armes du Danemark dans son propre blason en refusant, après demandes des ennemis, de les retirer, provoquant une réaction plus agressive de la part du roi danois. Ce qui fut donc l’un des éléments déclencheurs du conflit, qui s’insère dans les mêmes années que la Guerre de Livonie qui déstabilise la région.
Le déroulement de la guerre (1563-1570)
Ainsi, par les actions de la Pologne, du Danemark et de la Hanse, lorsque le conflit éclate le 13 août 1563, la Suède se retrouve isolée. Le Danemark, bénéficiant d’un accès plus facile aux mercenaires du nord-ouest de l’Allemagne, mobilise une armée imposante dès août 1563.
La campagne d’Älvsborg, qui fut la première de cette guerre, implique entre 25 000 et 28 000 soldats, soutenus par une flotte puissante de 27 navires de guerre transportant 4 600 hommes. Le siège d’Älvsborg débute rapidement : après trois jours de bombardements, une brèche suffisante fut créée, et la forteresse tomba le 4 septembre.
L’objectif du Danemark était de remporter une victoire décisive grâce à sa supériorité militaire, mais Éric XIV ne comptait pas se limiter à une guerre d’usure, en outre il espérait briser l’emprise danoise en Scandinavie en reprenant Älvsborg, en conquérant le Bohuslän et le Halland, ou en attaquant Trondheim par la Norvège pour obtenir un accès direct à la mer du Nord. Cependant, malgré des réformes militaires ambitieuses, la Suède ne parvint pas à renverser le rapport de force.
En 1565, la bataille d’Axtorna vit la défaite des Suédois face aux mercenaires danois commandés par Daniel Rantzau. Malgré la prise de Varberg par les Suédois en août 1565, la guerre s’enlise dans des affrontements coûteux et des campagnes de dévastation mutuelles, notamment en Scanie, en Småland et en Västergötland.
Sur mer, la situation évolue en faveur de la Suède. En effet, alors même que la guerre n’avait pas été déclarée, en 1563 une flotte danoise ouvrit le feu prêt de Bornholm sur une flotte suédoise, se terminant par une victoire de ces derniers.
Ces batailles montre que la mer est importante puisque en 1565, dans les mêmes eaux, un combat naval fut engagé, entre les 49 navires suédois et les 36 navires de l’alliance danoise, avec une victoire décisive des premiers, sous la direction de Klas Kristersson Horn. Ce dernier se distingue également le 26 juillet 1566 lors de la troisième bataille du nord d’Öland, où la flotte danoise fut de nouveau défaite. Ainsi le blocus infligé par Frédéric II, fut progressivement affaibli, facilitant les importations vitales pour la Suède.
Les conséquences du conflit
La guerre de Sept Ans du Nord se solde par le traité de Stettin en 1570, qui ne modifie pas significativement les frontières mais met fin à sept années de destruction. Si le conflit ne permet pas à la Suède d’atteindre ses objectifs initiaux, il affaiblit néanmoins le Danemark et amorce une transition vers une Suède plus puissante sur la scène Baltique, notamment au XVIe siècle.
De plus, la guerre a également des conséquences économiques, en effet à mesure que le conflit s’éternisait, les deux belligérants s’épuisèrent financièrement et militairement. Le Danemark, en particulier, avait accumulé une dette en tentant de financer ses mercenaires, qu’ils ne peuvent de ce fait plus payer. La Suède, quant à elle, dut faire face à l’incapacité de son armée paysanne à rivaliser durablement avec les troupes professionnelles danoises.
En 1568, un coup d’État en Suède dépose Éric XIV au profit de son frère Jean III, qui entame immédiatement des négociations avec le Danemark. Dans un premier temps, un projet de paix fut proposé à Roskilde en novembre 1568, mais il fut rejeté par la Suède. Finalement, après plusieurs années d’attrition, la paix fut conclue avec le traité de Stettin, signé le 13 décembre 1570.
Ce traité impose le retour au statu quo ante bellum : le roi de Suède renonce à ses revendications sur la Norvège, la Scanie, le Halland, le Blekinge et le Gotland, tandis que les Danois abandonnèrent leurs prétentions sur la Suède. La mer Baltique fut déclarée zone d’influence danoise. La Suède dut payer 150 000 riksdaler pour récupérer Älvsborg et restituer les navires capturés.
Une guerre méconnue mais révélatrice
Cette guerre, illustre donc l’importance de la maîtrise des mers, en particulier ici la mer Baltique, qui est au cœur des affrontement.
Dans les années qui suivirent ce conflit, la stratégie militaire des deux royaumes évolua et annonça les futurs affrontements qui allaient jalonner leur rivalité au cours des siècles suivants, puisque l’une des conséquences de cette guerre, fut la mise en place d’une armée permanente en Suède.
Quelques liens et sources utiles
FROST.R., The Northern Wars. War, state and society in Northeastern Europe, 1558-1721, Harlow, 2000.
SCHNAKENBOURG.E., MAILLEFER.J-M., La Scandinavie à l’époque moderne, Belin Sup, Paris, 2010.
WESTELING.G.O.F., Det nordiska sjuårskrigets historia, Norstedt, 1879.