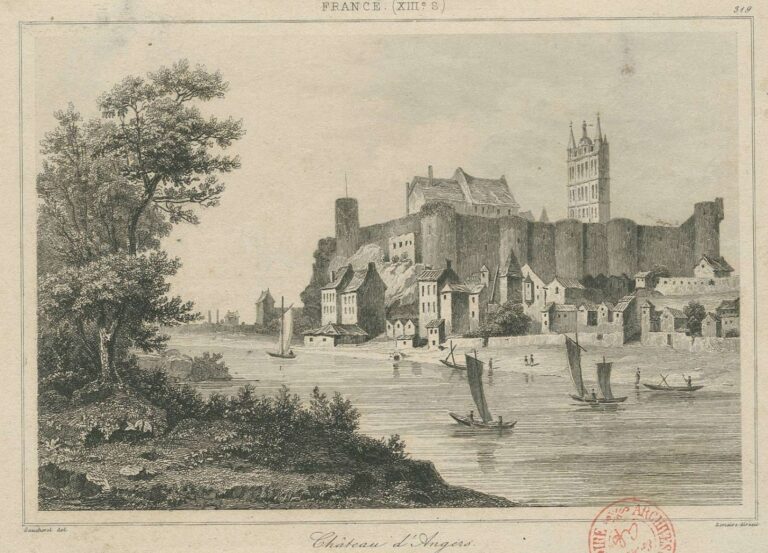L’article propose une méthode opérationnelle, du déchiffrage du sujet à la relecture finale. Il précise comment cadrer les notions, formuler une question directrice et bâtir une démonstration étayée par des exemples et des références d’historiens.
L’objectif est de fournir un pas-à-pas immédiatement réutilisable en cours et en examen pour une dissertation en histoire claire, structurée et convaincante.
Comprendre le sujet et poser le cadre
Définir précisément les termes, fixer des bornes cohérentes et dégager les enjeux implicites pour éviter le hors-sujet dès les premières minutes.
Définir les notions et les bornes
Un sujet se clarifie d’abord par la définition de ses mots clés et l’établissement d’un espace-temps justifié. Précisez ce que recouvrent les concepts, identifiez les acteurs, explicitez l’échelle retenue. Les bornes ne sont pas décoratives : elles orientent les sources mobilisables et la logique du plan.
Reformulez ensuite le sujet en une phrase simple afin de vérifier l’angle : cette reformulation prévient les digressions et prépare la future problématique.
Dégager l’enjeu et formuler la problématique
La problématique transforme le thème en une question qui met en tension continuités et ruptures. Elle doit être faisable avec vos connaissances et vos documents. Testez-la en listant deux ou trois pistes d’argumentation et quelques exemples. Une bonne problématique appelle naturellement un plan en deux ou trois parties complémentaires.
Restez précis : une question trop large dilue l’analyse, une question trop étroite interdit la démonstration.
Choisir un plan vraiment problématisé
Le plan thématique convient quand l’analyse compare des dimensions (politiques, sociales, économiques, culturelles). Le plan chronologique problématisé s’impose lorsqu’on suit des dynamiques (mise en place, apogée, recomposition).
Dans tous les cas, chaque partie répond à un sous-problème explicite, et chaque section commence par une phrase-thèse. Cette discipline évite le plan « catalogue » et garantit la lisibilité argumentative.
Construire l’introduction et le cœur de démonstration
L’introduction oriente la lecture ; le développement prouve, par des arguments structurés, des exemples précis et des références d’historiens bien situées.
Rédiger une introduction efficace
Une introduction réussie tient en quatre mouvements : une accroche brève, la définition des notions et le cadrage spatio-temporel, l’énoncé de la problématique, l’annonce du plan. La promesse doit être claire : montrer quoi, pourquoi et comment. Bannissez les généralités historiques trop vagues.
Terminez par une annonce concise des parties, formulée en mots directeurs, afin de donner au lecteur une carte de la démonstration sans en dévoiler tout le contenu.
Argumenter, exemplifier, citer des historiens
Chaque paragraphe défend une idée appuyée par un exemple précis (événement, donnée, carte, extrait) et, lorsque c’est pertinent, par un historien dont la thèse est rapidement située. Les références ne sont pas décoratives : elles servent l’argument. Évitez l’empilement d’auteurs ; privilégiez une citation pertinente et analysée.
Concluez chaque section par un court bilan qui prépare la suivante : la progression doit répondre pas à pas à la question posée.
Assurer transitions et cohérence d’ensemble
Les transitions explicitent le fil entre parties et rappellent la réponse provisoire à la problématique. Vérifiez la symétrie des sections, l’équilibre des exemples et l’unité du vocabulaire. Harmonisez les dates, les unités, les noms propres. Une relecture de cohérence détecte les redites, corrige les enchaînements et renforce la clarté des phrases-thèses.
Cette exigence de mise en forme participe pleinement de l’évaluation universitaire.
Conclure nettement et finaliser la copie
Répondre sans ambages à la question, ouvrir avec mesure et sécuriser les derniers points de forme avant rendu.
Répondre à la question et ouvrir pertinemment
La conclusion n’ajoute pas d’idées nouvelles : elle répond explicitement à la problématique et rappelle l’apport central de la démonstration. Une ouverture maîtrisée peut proposer un changement d’échelle, une comparaison ou une piste historiographique. Restez sobre et pertinent ; évitez les formules générales.
La dernière impression doit être celle d’un devoir mené à son terme, cohérent et utile pour la compréhension du sujet traité.
Relire, soigner la forme et gérer le temps
La forme compte : orthographe, syntaxe, ponctuation, titres hiérarchisés, légendes claires. En situation d’examen, répartissez le temps : analyse et brouillon, rédaction, relecture. Une vérification finale porte sur les citations, les dates, les enchaînements logiques et la conformité du plan annoncé.
Cette rigueur formelle valorise le fond et sécurise des points souvent décisifs dans l’appréciation globale.
Les questions qu’on se pose sur sa dissertation en histoire
1. Quel plan privilégier entre thématique et chronologique ?
Le bon plan est celui qui sert la question. Si l’analyse compare des dimensions, un plan thématique clarifie la démonstration. Si l’on suit des dynamiques, un plan chronologique problématisé s’impose. Dans tous les cas, chaque partie doit répondre à un sous-problème et commencer par une phrase-thèse. C’est la meilleure garantie contre l’énumération.
2. Faut-il citer des historiens dans chaque paragraphe ?
Il n’y a pas d’obligation mécanique. L’essentiel est d’utiliser des références pertinentes au bon endroit, en précisant la thèse mobilisée. Une citation courte mais analysée vaut mieux qu’un empilement d’auteurs. Pensez à varier les appuis : manuels, articles, dossiers, sources primaires commentées.
3. Combien d’exemples mobiliser par partie ?
Deux ou trois exemples solides suffisent, à condition d’être précis et analysés. L’objectif n’est pas d’accumuler des faits, mais d’étayer un raisonnement. Variez les natures d’exemples (événement, chiffre, carte, texte) et soignez les transitions pour montrer ce qu’ils prouvent dans la démonstration.
4. Comment éviter le hors-sujet dès l’introduction ?
Le cadrage initial est décisif : définitions nettes, bornes justifiées, reformulation du sujet en une phrase, problématique claire. L’annonce de plan doit découler de cette préparation. Une vérification rapide à la fin de l’introduction garantit l’alignement entre question, parties et exemples prévus.
Les points clés à retenir
- Cadrer le sujet par des définitions claires et des bornes justifiées.
- Formuler une problématique faisable qui organise le plan.
- Rédiger une introduction en quatre mouvements lisibles.
- Argumenter avec des exemples précis et des références situées.
- Conclure en répondant nettement et relire pour assurer la cohérence.
Quelques liens et sources utiles
Dominique Borne, Méthodes et techniques de l’historien, Armand Colin, 2010
Jean-Pierre Vernant, Introduction à l’étude des sciences historiques, Seuil, 2003
François Dosse, Méthodologie de l’histoire, Armand Colin, 2015
Yannick Clavé, Méthodologie de la dissertation en histoire : Classes préparatoires, licence, concours, Ellipses, 2021
Pierre Saly, François Hincker, Marie-Claude L’Huillier, Jean-Paul Scot, Michel Zimmermann, Le commentaire de documents en histoire – 3ED NP, Armand Colin, 2017
Pierre Saly, François Hincker, Marie-Claude L’Huillier, Jean-Paul Scot, Michel Zimmermann, La dissertation en histoire, Armand Colin, 2019