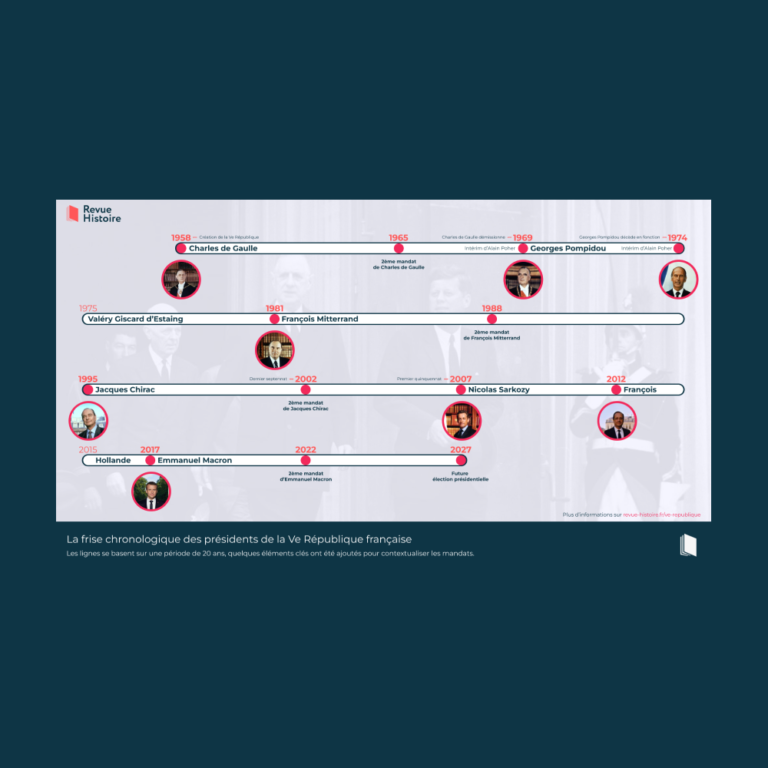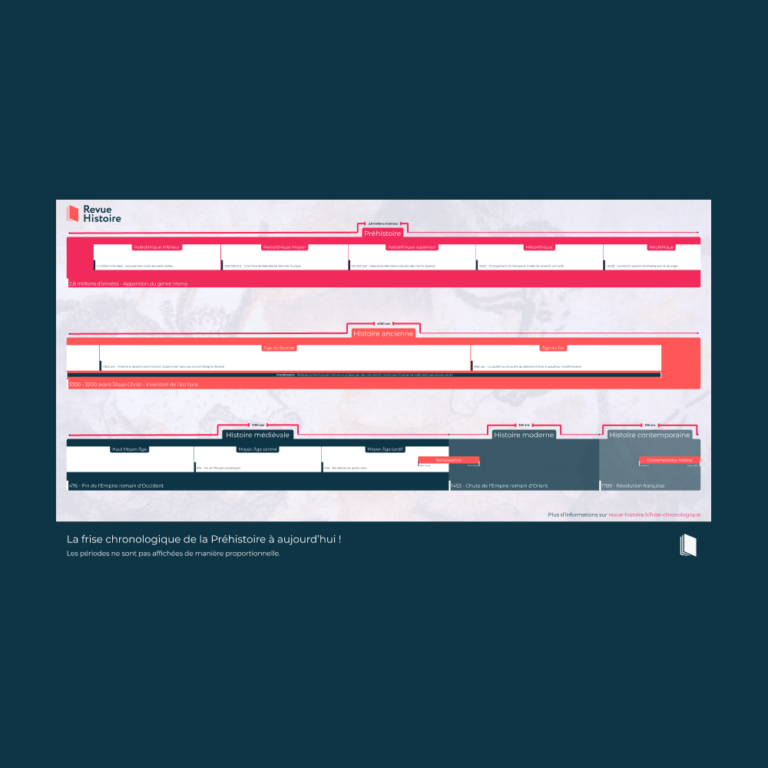La problématique est la colonne vertébrale d’un commentaire, d’une dissertation, d’un devoir : elle transforme un thème en question de recherche et oriente le plan.
Cet article explique comment formuler problématique avec méthode, du cadrage des notions au test de faisabilité. L’objectif est de fournir une procédure claire et réutilisable en TD comme en examen, pour gagner en précision, en cohérence argumentative et en pertinence sans alourdir la rédaction.
Comprendre ce qu’est une problématique
Définir la nature d’une problématique, ses critères de qualité et ses pièges fréquents afin d’éviter le hors sujet et les plans « catalogue ».
De la thématique à la question directrice
Une bonne problématique n’est ni un thème, ni un titre : c’est une question ouverte qui met en tension continuités et ruptures, acteurs et échelles. Elle doit être compréhensible, pertinente et orienter une démonstration en deux ou trois parties.
Reformuler le sujet en question permet d’expliciter l’angle d’attaque et d’anticiper les exigences du correcteur. Cette transformation est la condition pour passer d’un récit à une analyse.
Les critères d’une bonne problématique
Quatre critères guident l’évaluation :
- clarté de la question,
- mise en lumière d’un enjeu,
- capacité à structurer un plan logique
- adéquation au matériau disponible.
Une problématique trop vaste dilue l’argumentation ; trop étroite, elle interdit la démonstration. L’épreuve consiste à viser l’équilibre : une question assez ambitieuse pour susciter l’analyse, assez circonscrite pour permettre des réponses étayées et vérifiables dans le temps imparti.
Les erreurs à éviter absolument
Trois écueils reviennent : confondre sujet et problématique, proposer une « question » purement descriptive, ou empiler des questions sans fil directeur. S’ajoutent des formulations vagues, des concepts non définis et des bornes floues. Chacun de ces défauts se traduit par un plan déséquilibré et des transitions forcées. Les corriger en amont est le moyen le plus sûr de sécuriser la suite du devoir.
1) Confondre sujet et problématique
- À éviter (thème/titre) : La colonisation britannique en Inde (1757-1947).
- Version problématisée : En quoi la domination britannique a-t-elle à la fois unifié et fragmenté l’espace politique indien entre 1858 et 1947 ?
- Ce que ça corrige : on passe d’un simple champ d’étude à une tension qui oriente le plan (unification vs fragmentation).
2) Poser une question purement descriptive
- À éviter (inventaire) : Quelles sont les étapes de l’industrialisation en Allemagne ?
- Version problématisée : En quoi la chronologie et les acteurs de l’industrialisation allemande diffèrent-ils du modèle britannique, et que cela change-t-il pour la puissance allemande avant 1914 ?
- Ce que ça corrige : on quitte la liste des « étapes » pour une comparaison interprétative qui appelle démonstration.
3) Empiler des questions sans fil directeur
- À éviter (enchevêtrement) : Pourquoi la Révolution française éclate-t-elle, qui sont ses acteurs et quelles en sont les conséquences ?
- Version problématisée : Comment la crise fiscale et la politisation des Lumières reconfigurent-elles les rapports de souveraineté jusqu’à la rupture de 1789 ?
- Ce que ça corrige : une cause directrice organise le plan (crise fiscale → politisation → bascule de souveraineté).
4) Formulations vagues
- À éviter (flou) : La place des femmes hier et aujourd’hui ?
- Version problématisée : En quoi les mobilisations féministes de 1968-1982 ont-elles redéfini le droit au travail en France, et avec quelles limites ?
- Ce que ça corrige : on précise période, échelle, objet, ce qui rend la preuve possible.
5) Concepts non définis
- À éviter (concept-valise) : La mondialisation est-elle positive ?
- Version problématisée (concept outillé) : Comment l’ouverture commerciale des années 1990 a-t-elle reconfiguré les chaînes de valeur du textile au Bangladesh, et avec quels effets sociaux mesurables ?
- Ce que ça corrige : on remplace un jugement flou par un mécanisme (ouverture → reconfiguration → effets), avec indicateurs.
6) Bornes spatio-temporelles floues
- À éviter (périmètre indéfini) : Les migrations en Europe.
- Version problématisée : En quoi l’élargissement de 2004 a-t-il reconfiguré les flux migratoires intra-UE entre 2004 et 2013, et selon quelles lignes sectorielles ?
- Ce que ça corrige : bornes nettes (événement déclencheur + fenêtre temporelle) et critère d’analyse (secteurs).
7) « Plan catalogue » déguisé en problématique
- À éviter (faux guide) : Quels sont les aspects politiques, économiques, sociaux et culturels du New Deal ?
- Version problématisée : Comment l’architecture institutionnelle du New Deal a-t-elle déplacé l’équilibre entre État fédéral et acteurs privés tout en redéfinissant les arbitrages sociaux (1933-1939) ?
- Ce que ça corrige : on évite la juxtaposition de « dimensions » au profit d’un fil causal qui traversera toutes les parties.
Mini-checklist « anti-pièges »
- Remplace tout intitulé nominal par une question qui met en tension au moins deux éléments.
- Bannis les verbes de pure description (énumérer, présenter, retracer) au profit de expliquer, comparer, montrer en quoi.
- Fige trois paramètres avant d’écrire : période, échelle, concepts définis.
- Teste ta question : peux-tu annoncer 2 à 3 thèses et au moins 2 exemples pour chacune ? Si non, rétrécis l’angle.
Méthode pour construire une problématique
Appliquer une procédure en trois temps : analyser le sujet, transformer en question, tester puis ajuster selon les sources et l’historiographie.
Analyser le sujet et cadrer précisément
Commencer par définir les termes clés, identifier les acteurs, fixer des bornes spatio-temporelles justifiées. Cette étape évite le hors-sujet et prépare la sélection des exemples. La reformulation du sujet en une phrase simple vérifie l’angle et révèle les tensions potentielles.
On obtient ainsi une base solide pour formuler une question qui interroge des mécanismes, des dynamiques ou des hiérarchies plutôt que de demander une simple description.
Transformer le cadrage en question de recherche
À partir du cadrage, rédiger une question commençant par « Comment », « Pourquoi » ou « En quoi ». La problématique doit laisser place à l’argumentation, pas à l’énumération. On vérifie la présence d’un enjeu interprétatif et d’un fil directeur susceptible d’organiser deux ou trois mouvements.
L’annonce ultérieure du plan découlera de cette question, ce qui accroît la lisibilité de l’introduction et la cohérence du développement.
Tester, ajuster et valider
Avant de figer la question, la confronter aux sources disponibles et à quelques repères historiographiques. Si la matière manque, rétrécir l’angle ; si elle déborde, préciser l’échelle ou la période. Un test efficace consiste à lister deux arguments possibles et leurs exemples. Si l’exercice échoue, la question est à reformuler. Ce va-et-vient entre idée et preuves garantit une problématique faisable et productive.
Articuler problématique, plan et démonstration
Coordonner question, architecture du devoir et progression argumentative pour éviter le « catalogue » et assurer la cohérence.
Choisir une architecture adaptée
Deux formats dominent.
- Le plan thématique convient quand on compare des dimensions (politique, social, économique, culturel).
- Le plan chronologique problématisé s’impose pour montrer des dynamiques (mise en place, apogée, recomposition).
Dans tous les cas, chaque partie répond à un sous-problème explicite et commence par une phrase-thèse. Ce calage rend visibles les réponses partielles à la question centrale.
Garantir la cohérence tout au long du devoir
La cohérence se construit par des transitions qui récapitulent et ouvrent, un lexique stable, des dates homogènes et des références d’historiens situées. Chaque paragraphe doit prouver quelque chose en lien direct avec la problématique. En fin de rédaction, une relecture de structure vérifie l’alignement question-plan-preuves et l’absence de digressions. Cette discipline formelle pèse réellement dans l’évaluation universitaire.
Les questions qu’on se pose sur formuler problématique
Faut-il toujours commencer la problématique par « En quoi » ou « Comment » ?
Non, mais une question ouverte de ce type favorise l’analyse. L’important est de poser une tension explicite, de cibler un mécanisme et d’indiquer un angle interprétatif. Une question fermée ou purement descriptive affaiblit la démonstration et conduit au plan catalogue. L’examinateur attend un raisonnement guidé par une interrogation précise, pas un récit d’événements.
Comment savoir si ma problématique est trop large ou trop étroite ?
Testez la faisabilité : disposez-vous d’au moins deux arguments étayés par des exemples distincts dans le temps imparti ? Si tout rentre sans choix, l’angle est trop ample ; si rien ne permet d’argumenter, il est trop serré. Ajustez période, échelle ou acteurs pour viser une question à la fois ambitieuse et maîtrisable.
Peut-on retoucher la problématique en cours de rédaction ?
Oui, à condition d’en conserver la logique. La recherche affine la question ; il est normal de la préciser après confrontation aux sources et aux lectures.
Mettez alors à jour l’introduction et surveillez la cohérence de l’annonce de plan. L’essentiel est que la copie présente une interrogation claire, assumée et suivie jusqu’à la conclusion.
Les points clés à retenir
- Définir précisément les notions et fixer des bornes justifiées.
- Transformer le sujet en question ouverte portant un enjeu clair.
- Vérifier faisabilité et équilibre avant de figer la question.
- Choisir un plan adapté et le lier explicitement à la problématique.
- Assurer la cohérence par transitions, lexique stable et exemples probants.
Quelques liens et sources utiles
François Dosse, Méthodologie de l’histoire, Armand Colin, 2015
Yannick Clavé, Méthodologie de la dissertation en histoire : Classes préparatoires, licence, concours, Ellipses, 2021
Pierre Saly, François Hincker, Marie-Claude L’Huillier, Jean-Paul Scot, Michel Zimmermann, Le commentaire de documents en histoire – 3ED NP, Armand Colin, 2017
Pierre Saly, François Hincker, Marie-Claude L’Huillier, Jean-Paul Scot, Michel Zimmermann, La dissertation en histoire, Armand Colin, 2019