Le commentaire de document en histoire évalue votre capacité à identifier un matériau, à le situer et à en tirer une démonstration problématisée.
Cet article propose un pas-à-pas opérationnel, de l’identification initiale à la rédaction finale, en passant par la contextualisation, l’analyse interne et la critique externe. Objectif : produire une lecture rigoureuse, étayée par des exemples et des références, claire dans sa structure et précise dans ses conclusions.
Identifier et cadrer le document
Définir ce que l’on a sous les yeux, établir l’origine et le statut, puis poser des hypothèses d’usage historique qui guideront le reste de l’analyse.
Nature, auteur, date, source
Commencez par qualifier la nature du document (texte normatif, lettre, affiche, photographie), nommer l’auteur ou le producteur, dater précisément et indiquer la source (fonds, édition, cote, URL pérenne). Cette fiche d’identité conditionne l’interprétation du vocabulaire, le public visé et la portée juridique ou symbolique. Situez la chaîne de transmission (original, copie, transcription), car un décalage entre production et publication peut infléchir la lecture.
Statut, destinataire, objectif
Précisez le statut (officiel, privé, médiatique) et le destinataire. Explicitez l’objectif : informer, prescrire, convaincre, célébrer, dénoncer. Un même énoncé change de valeur selon le registre. Une proclamation joue sur la performativité, une correspondance intime dévoile des représentations, un rapport chiffré engage des procédures.
Ces marqueurs orientent déjà la future critique externe et préparent la sélection des passages à commenter prioritairement.
Indices matériels et paratextuels
Relevez les indices matériels (support, format, sceaux, papier, tirage) et paratextuels (titre, légende, signatures, crédits iconographiques). Ils renseignent sur la fabrication, la circulation et l’audience. Une mise en page solennelle, un tirage massif ou une vignette symbolique éclairent l’intention et la réception attendue.
Croisez ces éléments avec l’identité de l’émetteur et les conditions de diffusion pour affiner vos premières hypothèses.
Contextualiser et analyser
Mettre le document en perspective historique, croiser échelles, acteurs et dynamiques, puis lire le contenu pour dégager idées, procédés et preuves.
Repères chronologiques et spatiaux
Ancrez l’objet dans un moment précis et un espace pertinent. Situez événements immédiats, réformes en cours, tensions sociales ou diplomatiques qui donnent sens au document. Le contexte n’est pas un récit parallèle : il sélectionne les repères nécessaires pour comprendre pourquoi le document existe, ce qu’il tente de résoudre, et comment il s’insère dans une séquence plus large sans anachronisme.
Analyse interne : idées et procédés
Dégagez l’idée directrice, les arguments, les exemples et les procédés rhétoriques (métaphores, injonctions, statistiques) ; pour une image, analysez cadrage, couleurs, symboles, composition. Relevez mots récurrents et oppositions structurantes.
Montrez comment l’énoncé produit du sens : valeurs promues, adversaires construits, contradictions laissées visibles. Citez brièvement et commentez toujours, afin que l’extrait serve la démonstration.
Critique externe : fiabilité et biais
Évaluez la fiabilité en fonction de l’auteur, du contexte de production, du mode de diffusion et des objectifs. Tous les documents comportent des biais, mais ils restent informatifs si on les identifie : propagande, autocensure, intérêt institutionnel. Confrontez avec des sources indépendantes. Une lettre n’a pas la même prétention de vérité qu’un registre administratif ; inversement, un chiffre peut être instrumentalisé. Calibrez la confiance sans disqualifier hâtivement.
Restituer et structurer le commentaire
Organiser l’exposé, articuler transitions et bilans, normaliser la référence et assurer la traçabilité de la recherche.
Un plan problématisé et lisible
Annoncez une problématique claire, puis choisissez un plan adapté : thématique (enjeux, acteurs, effets) ou chronologique problématisé (genèse, apogée, recomposition). Chaque partie répond à un sous-problème explicite et s’ouvre par une phrase-thèse. Concluez chaque section par un bilan court qui relie l’observation à la question centrale. Ce calage évite le catalogue et maintient la progression argumentative.
Transitions, citations et cohérence
Soignez les transitions entre identification, contexte, analyse et critique. Intégrez des citations courtes, précisément référencées et immédiatement commentées. Harmonisez dates, unités, noms propres, et veillez à la stabilité du lexique. Vérifiez la conformité entre l’annonce de plan, les titres et les conclusions partielles. Une rédaction claire et resserrée valorise la méthode et facilite l’évaluation universitaire.
Quelques exemples
Vous pouvez réaliser vos propres exercices de commentaire de texte grâce à des sources historiques. Vous pouvez trouver des sources directement sur Revue Histoire, notamment :
- Lettre d’un mari sexuellement frustré à l’abbé Viollet
- L’appel à la première croisade par Robert le Moine
- Le testament de Gonzalo Ferrándiz pour l’Abbaye de Sahagún
Les questions qu’on se pose sur commentaire de document en histoire
Faut-il tout résumer avant d’analyser ?
Non. Il suffit d’identifier l’essentiel puis de sélectionner les passages clés. Un résumé exhaustif noie l’argument. L’analyse doit montrer comment le document produit du sens et ce qu’il prouve. Le temps gagné sert à construire des liens explicites avec la problématique et à justifier les choix d’extraits.
Comment éviter l’anachronisme ?
Restez fidèle au contexte de production : vocabulaire, institutions, normes du temps. Confrontez le document à des sources contemporaines et à des repères chronologiques précis. Si vous mobilisez des concepts postérieurs, explicitez le décalage. Cette vigilance limite les projections et crédibilise la démonstration sans affadir l’interprétation.
Quelle place donner aux citations ?
Peu, mais utiles. Privilégiez des extraits courts, référencés, immédiatement commentés. Chaque citation doit servir un argument, non le remplacer. Évitez l’empilement et préférez une mise en perspective avec d’autres passages ou d’autres sources pour éprouver la robustesse de l’interprétation proposée.
Comment évaluer la représentativité ?
Demandez-vous si le document est typique d’une pratique ou singulier. Cherchez des pièces comparables, repérez séries et récurrences. Une affiche unique éclaire un usage spécifique ; une collection d’arrêtés révèle une politique suivie. Mentionner les limites (lacunes, versions divergentes) encadre la portée de la conclusion sans l’affaiblir.
Les points clés à retenir
- Identification : préciser nature, auteur, date, source ; statut, destinataire, objectif ; relever indices matériels et paratextuels pour poser les premières hypothèses.
- Contextualisation : ancrer le document par des repères chronologiques et spatiaux ; situer acteurs, institutions, publics ; relier aux débats et à l’historiographie.
- Analyse interne : dégager l’idée directrice, les arguments et procédés (textuels ou visuels) ; citer brièvement et commenter immédiatement chaque extrait.
- Critique externe : évaluer fiabilité et biais ; tester la représentativité ; croiser avec d’autres sources indépendantes pour calibrer la confiance.
- Restitution : formuler une problématique claire ; choisir un plan thématique ou chronologique problématisé ; soigner transitions, citations normalisées et traçabilité.
Quelques liens et sources utiles
Yannick Clavé, Méthodologie de la dissertation en histoire : Classes préparatoires, licence, concours, Ellipses, 2021
Pierre Saly, François Hincker, Marie-Claude L’Huillier, Jean-Paul Scot, Michel Zimmermann, Le commentaire de documents en histoire – 3ED NP, Armand Colin, 2017
Pierre Saly, François Hincker, Marie-Claude L’Huillier, Jean-Paul Scot, Michel Zimmermann, La dissertation en histoire, Armand Colin, 2019

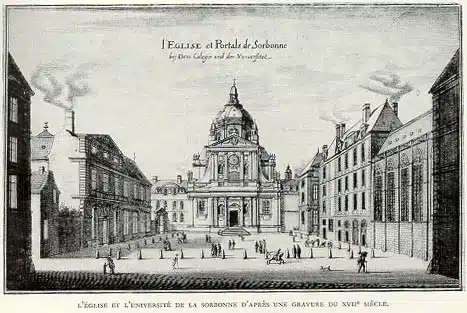






4 réponses
Merci pour cet article très utile et instructif. Il m’a vraiment beaucoup aidé
Avec grand plaisir.
Bonjour ,
Article très intéressant je suis en l1 histoire , en reprise d’études , et malheureusement en raison de mon emploi je ne peux suivre les td ,je serais intéressé par des exercices corrigé de commentaire de texte .
Bonjour,
Contactez-nous via le formulaire de contact du site, pour voir ce que nous pouvons faire.
Bien à vous.