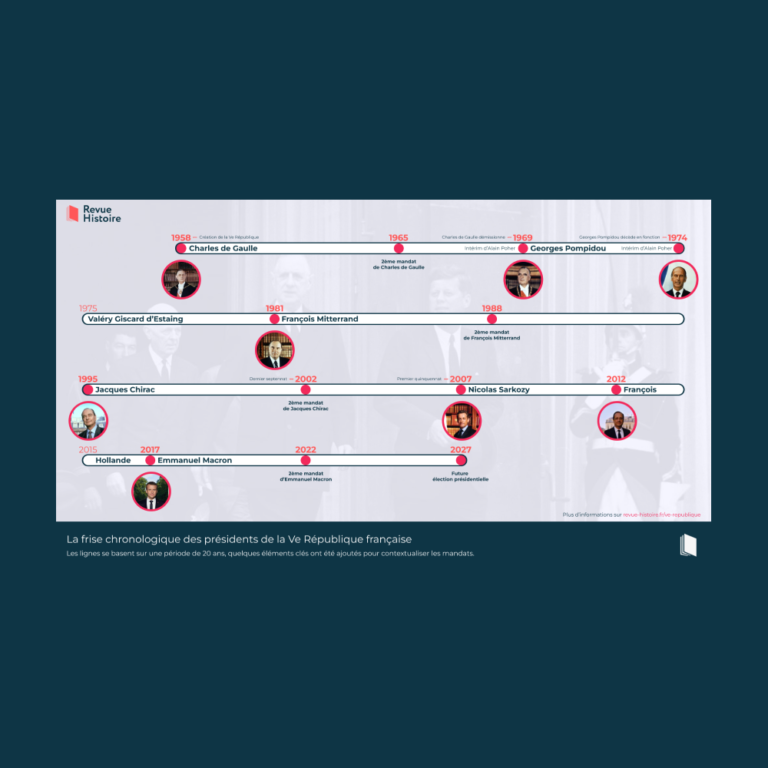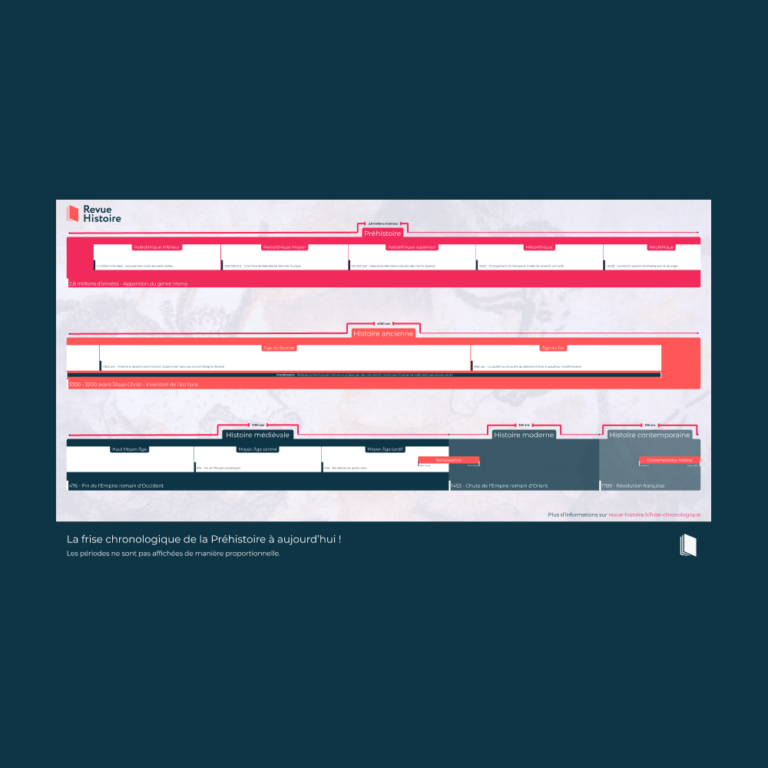Qui dit figure emblématique de la construction européenne dit incontestablement Jean-Claude Juncker. Cet homme d’Etat luxembourgeois a en effet joué ces 40 dernières années un rôle déterminant dans les transformations majeures de l’Union européenne, aussi bien pour le traité de Maastricht que pour l’apparition de l’euro. Retour sur le parcours d’un homme qui a su allier vision fédéraliste et pragmatisme politique au service de l’intégration européenne.
Origines et parcours luxembourgeois
Jean-Claude Juncker est né le 9 décembre 1954 à Redange-sur-Attert, au Luxembourg. Son père, réquisitionné par la Wehrmacht, lui donne très vite une aversion profonde envers la guerre, et une méfiance viscérale vis-à-vis de toute forme de nationalisme.
Ayant la volonté d’agir concrètement pour éviter ces dérives, c’est logiquement que celui qui a fait et réussi des études de droit à Strasbourg a décidé de faire de la politique son métier, sans jamais avoir exercé comme avocat.
Après avoir rejoint le Parti populaire chrétien-social (CSV) à l’âge de 20 ans en tant que simple sympathisant, Jean-Claude Juncker finit par devenir en 1979 le secrétaire parlementaire du parti. Il grimpe ensuite progressivement les échelons jusqu’à devenir en 1984 ministre du Travail et ministre délégué au budget à seulement 29 ans. Ses responsabilités vont ensuite progressivement augmenter, et Juncker devient en 1989 ministre du Travail et des Finances.
Réputé pour sa patience et pour ses qualités de négociateur, Jean-Claude Juncker est finalement nommé Premier ministre du Luxembourg en janvier 1995. Il occupe ce poste pendant près de 19 ans, ce qui est un record dans l’UE de 19 ans. En parallèle de ce poste, il continue à diriger les Finances du Grand-Duché jusqu’en 2009, et s’affirme ainsi comme un acteur clé de la fiscalité européenne.
Un architecte de l’Union économique et monétaire
L’engagement européen de Jean-Claude Juncker débute en 1985. A cette époque, le Luxembourg préside le Conseil des Communautés européennes, et du fait de son poste de ministre, Juncker dirige les Conseils “Affaires sociales et “Budget”.
Lorsque son pays récupère la présidence du Conseil des communautés européennes en 1991, Juncker récupère cette fois-ci la présidence du Conseil “Affaires économiques et financières”. De ce fait, Juncker s’affirme au cœur de la construction du traité de Maastricht (1992), qui n’est ni plus ni moins que le traité fondateur de l’Union européenne, et de l’euro.
Tout en étant ministre des Finances du Luxembourg, Juncker s’engage ainsi pleinement les années suivantes en faveur de la création de cette monnaie unique. Ayant une vision fédéraliste pragmatique, Juncker était alors persuadé que l’intégration européenne devait assurément passer par une transcendance progressive de la souveraineté nationale, d’où son travail acharné qui aboutit officiellement à la création de l’euro le 1er janvier 1999. Grâce à sa ferveur, l’Union économique et monétaire est alors affirmée, et l’Union européenne devenue une association sérieuse.
Nous avons créé l’euro sur la seule base viable au sein de l’Union européenne : celle d’Etats souverains qui acceptent” (Déclaration de Jean-Claude Juncker au journal Le Temps en février 2012)
Par la suite, Jean-Claude Juncker est nommé en 2005 premier président permanent de l’Eurogroupe. Concrètement, il dirigeait des réunions mensuelles réunissant les ministres des Finances des différents pays de la zone euro dans le but de coordonner au mieux les politiques économiques. Ayant connu la crise financière de 2008 et la crise de la dette souveraine, Juncker a ainsi été au coeur de la gestion européenne d’événements complexes. Il a aussi dû faire face à la crise de la dette grecque (2010-2012), et a réussi à défendre le maintien de la Grèce dans la zone euro au travers d’une approche mêlant solidarité et discipline budgétaire. C’est d’ailleurs grâce à lui qu’ont été conçus les premiers plans de sauvetage, ainsi que le Mécanisme européen de stabilité (MES), doté de 700 milliards d’euros.

La présidence de la Commission européenne entre fédéralisme et souveraineté européenne
Après avoir quitté l’Eurogroupe en 2013, Jean-Claude Juncker est élu le 1er novembre 2014 12e président de la Commission européenne, grâce au nouveau système des “Spitzenkanditaten” (= candidats tête de liste). Et dès le début de son mandat, Juncker a manifesté l’envie de faire une “politique, une très politique Commission”, loin de l’image technocratique qui se dégageait alors de l’institution.
En ce sens, il a très vite dévoilé un projet concret : “une Union européenne plus grande, plus ambitieuse pour les grands dossiers, plus petite et plus modeste pour les petits dossiers”. Ses priorités ont quant à elles été annoncées dès le départ : emploi et croissance, marché unique numérique, union énergétique, union économique et monétaire approfondie et renforcement du rôle international de l’Europe.
Mais pour arriver à ses fins, Jean-Claude Juncker sait qu’il doit d’abord relancer l’investissement européen, mis à mal par l’ensemble des dernières crises financières. C’est la raison pour laquelle naît en 2015 le Fonds européen pour les investissements stratégiques, dit plan Juncker. Grâce à ce dernier, 315 milliards d’euros ont été mobilisés pour relancer l’Union européenne économiquement. Bilan : au moins 1,7 million d’emplois créés dans toute l’Europe.

Par la suite, sous sa présidence a été adopté en 2016 le Règlement général sur la protection des données, entré en vigueur en 2018, qui est devenu une référence mondiale en matière de protection des données personnelles. Juncker était également en place lors de la fin du roaming en 2017, c’est-à-dire la disparition des frais d’itinérance téléphonique à l’intérieur de l’UE. Enfin, en 2019, c’est la commission Juncker qui a adopté en 2019 une stratégie de neutralité carbone pour 2050, qui a ensuite ouvert la voie au Pacte vert européen de sa successeure, Ursula von der Leyen.
Des blessures et des scandales
Mais le mandat de Jean-Claude Juncker, conclu en 2019, est loin d’avoir été tout rose. C’est en effet sous sa présidence qu’a eu lieu notamment le Brexit, qui est un grand échec pour l’UE.
L’ancien président regrette notamment d’avoir trop écouté le gouvernement de David Cameron, alors Premier ministre britannique, qui lui a personnellement demandé de rester en retrait lors des phases de débat précédant le référendum. Faute de pouvoir intervenir pour donner des arguments en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l’UE, le fédéraliste pragmatique qu’est Juncker n’a pu qu’observer sans rien faire le Brexit avoir lieu. Un “gaspillage de temps et d’énergie” qui s’est déroulé au détriment d’autres priorités européennes.
Jean-Claude Juncker a aussi dû affronter en 2014 le scandale LuxLeaks, qui a révélé que des centaines de multinationales avaient obtenu des accords fiscaux très avantageux au Luxembourg sous ses mandats. Si Juncker s’est d’abord défendu en arguant que ces pratiques étaient légales et répandues en Europe, il s’est finalement quelque peu ravisé en reconnaissant avoir commis une “négligence” en matière de concurrence fiscale. Une affaire qui a terni son entrée en matière à la Commission européenne, sans pour autant ternir son mandat entier.
Jean-Claude Juncker a aussi quelques échecs au sujet de ses ambitions avancées en faveur de la souveraineté européenne. Son projet de fusionner les présidences du Conseil européen et de la Commission en “un seul capitaine” exécutif élu démocratiquement n’a par exemple jamais vu le jour, de même que son projet de créer un ministre européen de l’économie et des finances.
Mais si l’on regarde son mandat avec le recul, on peut affirmer que Jean-Claude Juncker a été un bon président de la Commission européenne. Il a en effet réussi en cinq ans à refaire de ce dernier un acteur politique à part entière, sachant se montrer autoritaire face aux institutions intergouvernementales.
De lui l’on peut retenir sa vision d’intégration européenne progressive qui prenait en compte les contraintes nationales, la primauté qu’il accordait aux résultats concrets sur les débats idéologiques, et bien entendu sa faculté unique de médiation. Européen convaincu, Juncker a su rendre l’UE plus forte économiquement, à défaut d’avoir eu le temps de la rendre insubmersible politiquement.
Quelques liens et sources utiles :
Margaretha Kopeinig, Jean-Claude Juncker: Der Europäer, Czernin, 2004