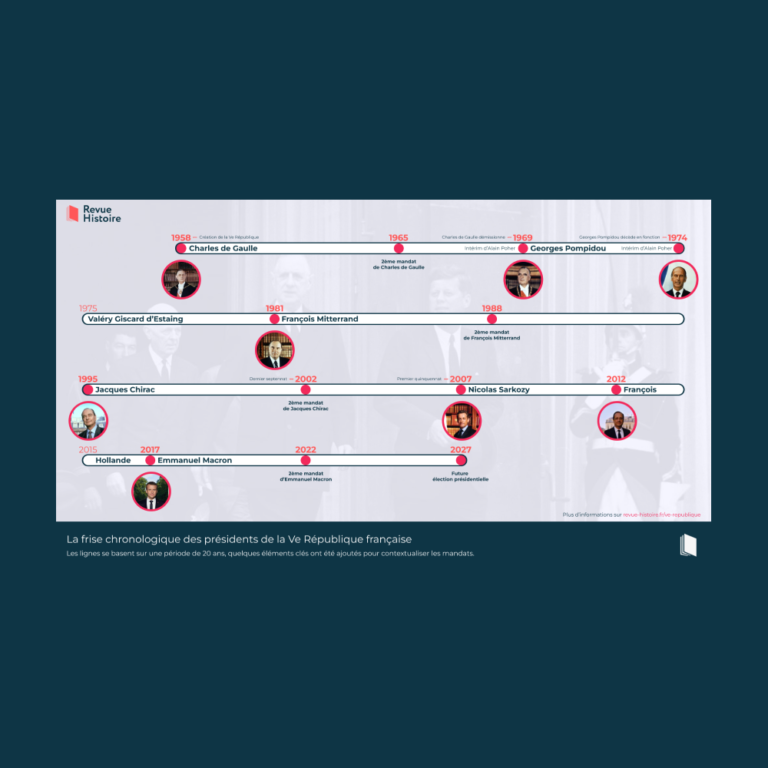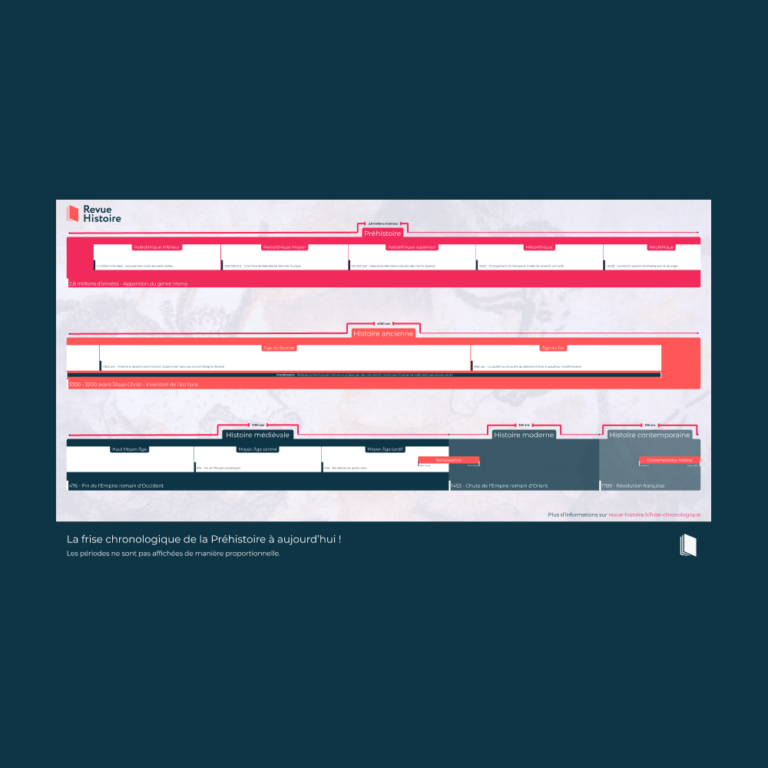Les déserts et les zones arides représentent pas moins de 45% de la surface terrestre. Dans ces environnements hostiles, difficile d’imaginer une quelconque forme de vie y survivre.
C’est pourtant le cas des espèces xérophiles, qui non seulement y vivent, mais y prospèrent. Retour sur les stratégies d’adaptation de ces êtres vivants dans ces endroits où l’eau est rare et les températures extrêmes.
Qu’est-ce qu’un xérophile ?
Le terme xérophile vient du grec ancien xeros, qui signifie “sec” et philos, qui signifie “ami de”. De façon concrète, cela désigne tous les organismes qui ne peuvent vivre que dans des milieux très pauvres en eau disponible.
Un xérophile est en ce sens différent d’un xérophyte, qui, lui, peut survivre en milieu humide sous certaines conditions.
Stratégies des végétaux xérophiles
Pour optimiser leur utilisation de l’eau, les végétaux xérophiles ont développé de multiples stratégies d’adaptation morphologique, toutes aussi brillantes les unes que les autres.
Certaines plantes adaptent par exemple leur système racinaire. En développant des racines pouvant aller jusqu’à 50 mètres de profondeur, des plantes xérophiles sont ainsi capables de puiser dans les nappes phréatiques pour s’abreuver. D’une autre façon, quelques espèces étendent leurs racines de façon horizontale pour capter la moindre goutte possible de rosée.
Des modifications foliaires peuvent aussi avoir lieu. Si tel est le cas, les plantes peuvent alors réduire leurs feuilles jusqu’à devenir des épines. Un stratagème intelligent, car cela limite le phénomène de transpiration de 90% par rapport à une feuille plate. L’enroulement et le développement d’une cuticule épaisse et cireuse sont aussi des moyens pour les végétaux xérophiles de limiter leur surface d’évaporation.
Chez les cactacées, les tiges ont même la particularité de faire la photosynthèse à la place des feuilles, et en profitent pour développer des côtes longitudinales qui viennent créer des zones d’ombre.

Physiologiquement, les plantes xérophiles sont aussi connues pour leur métabolisme CAM. Concrètement, cela consiste pour elles à décaler leur photosynthèse la nuit afin de réduire la perte d’eau liée à ce phénomène. En ouvrant quand il fait plus frais leurs stomates (= ce qui leur permet de respirer), elles continuent ainsi à absorber le CO₂ dont elles ont besoin sans se dessécher.
Stratégie des animaux xérophiles
Comme les végétaux, les animaux xérophiles ont développé des stratégies sophistiquées pour ne pas être soumis à la déshydratation.
Le dromadaire, par exemple, stocke de la graisse pour produire de l’eau métabolique. Cela lui permet ainsi de tenir longtemps dans des milieux arides, quand les 150 litres d’eau qu’il est capable de boire en à peine dix minutes sont épuisés. De façon globale, il est capable de survivre avec une déshydratation allant jusqu’à 25% de son poids corporel, ce qui en fait l’animal xérophile par excellence.
Certains animaux, comme le fennec, utilisent aussi la régulation thermique. Si l’on détaille le processus, ses grandes oreilles sont parcourues par un réseau dense de capillaires sanguins, qui permet alors au sang d’évacuer assez facilement vers l’air la chaleur corporelle qu’il a absorbée. Le pelage clair du fennec réfléchit aussi une partie du rayonnement solaire, tandis que ses poils épais isolent la chaleur le jour pour ne pas le déshydrater.

De façon plus évidente, d’autres animaux xérophiles adoptent un mode de vie nocturne. Certains pratiquent même l’estivation, c’est-à-dire l’hibernation mais en été, en se réfugiant dans des terriers souterrains lorsque les températures deviennent trop lourdes.
Le cas des micro-organismes xérophiles
Les micro-organismes xérophiles font probablement partie des êtres vivants les plus stupéfiants. Ces organismes unicellulaires, qui sont principalement des bactéries et des archées, vivent en effet dans des conditions qui défient toute imagination.
Plusieurs communautés microbiennes arrivent notamment à prospérer jusqu’à quatre mètres de profondeur dans le désert d’Atacama, qui n’est ni plus ni moins que le désert le plus aride au monde (31 mm de précipitations annuelles).
Cette résistance au dessèchement s’explique par le fait que ces micro-organismes sont capables de synthétiser des osmolytes compatibles (= molécules protectrices), comme le tréhalose et les bétaïnes, afin de stabiliser leurs protéines et leurs membranes cellulaires. Les osmolytes agissent alors comme une sorte de gel de protection interne. De ce fait, même quand l’eau disparaît, les protéines et les membranes des micro-organismes xérophiles restent intactes et prêtes à repartir dès que l’humidité revient.
Par ailleurs, les micro-organismes xérophiles disposent également de systèmes de réparation de l’ADN extrêmement performants, ce qui leur permet de réparer sans tarder les dégâts qu’auraient pu causer sur eux le dessèchement.
Mais au-delà de leurs caractéristiques, les micro-organismes xérophiles sont très importants sur le plan écologique. Ces derniers forment en effet des croûtes biologiques servant à stabiliser les sols et à lutter contre la désertification. Quelques cyanobactéries sont mêmes capables de fixer l’azote atmosphérique, d’où l’intérêt de s’y intéresser dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.
Les menaces et les espoirs sur les xérophiles
Si la résistance des xérophiles n’est plus à prouver, elle est en revanche mise à rude épreuve ces dernières années. Entre le changement climatique qui modifie les régimes de précipitations, le surpâturage qui dégrade les sols et le développement d’espèces invasives qui perturbe les équilibres écologiques, les xérophiles subissent, et certaines espèces en viennent même à disparaître faute d’habitats adaptés.
À l’heure où les zones arides s’étendent progressivement sous l’effet du réchauffement climatique, conserver ces écosystèmes prodigieux est un enjeu majeur à ne surtout pas sous-estimer dans le futur, ne serait-ce que pour comprendre comment aider la biodiversité à s’adapter aux conditions les plus extrêmes.
Mais pour comprendre comment ⅓ des hauts lieux mondiaux de la biodiversité se trouve dans des zones arides, il y a encore beaucoup de travail…
Quelques liens et sources utiles :
Cactus Store, Xerophile, Revised Edition: Cactus Photographs from Expeditions of the Obsessed, Ten Speed Press, 2021