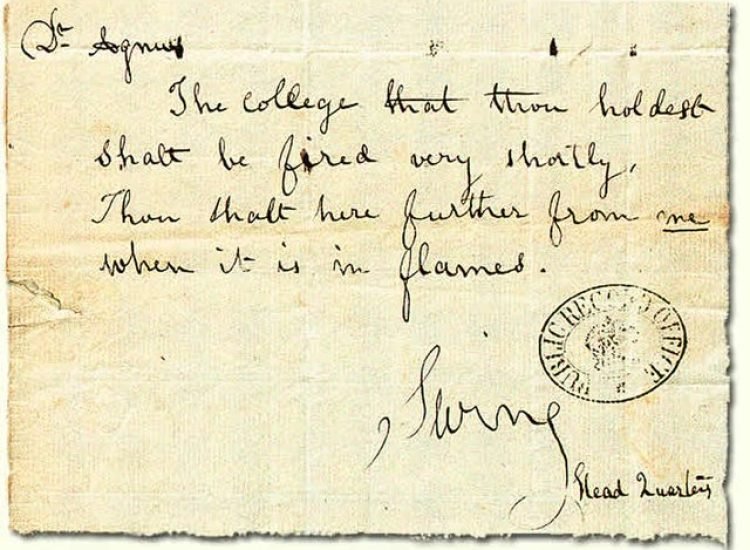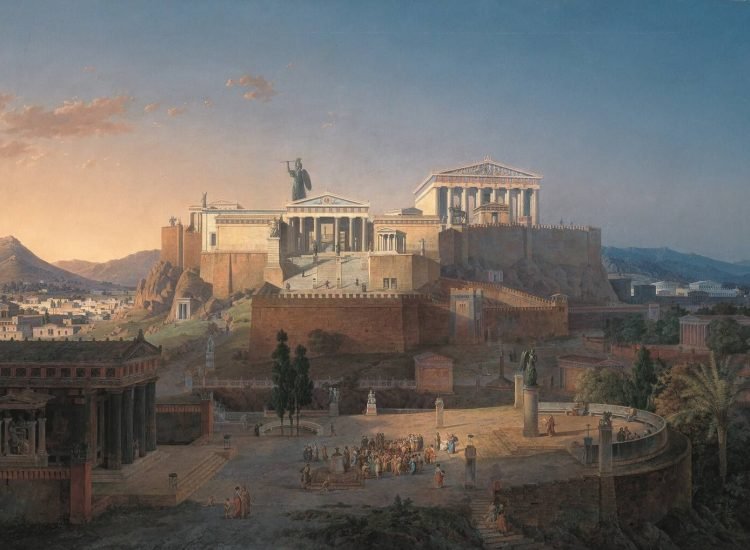« En 1957, alors que les Soviétiques lançaient Spoutnik, un lecteur du journal Le Monde s’étonnait : “Qui va suivre ?” Cette question a trouvé sa réponse en un demi-siècle de conquêtes spatiales.
Aujourd’hui, plusieurs organisations nationales et régionales rivalisent de projets et de lancements.
Les pionniers américains et européens
La fin de la Seconde Guerre mondiale a été l’occasion pour les vainqueurs de se partager les découvertes allemandes, à la fois militaires, scientifiques et sociales.
Dans le cadre de la conquête spatiale, ce sont les ingénieurs et scientifiques des programmes V1 et V2 qui vont activement participer au développement des programmes des États-Unis et de la France.
NASA : la force historique
La National Aeronautics and Space Administration (NASA), créée en 1958, demeure l’agence spatiale la plus connue. Elle a mené les programmes Mercury, Gemini et Apollo, culminant avec le premier pas de l’homme sur la Lune en 1969.
Depuis, la NASA a développé les navettes spatiales, la station ISS, et les sondes vers Mars et les confins du système solaire.
Son expertise et son développement fulgurant sont dus en partie à Wernher von Braun. Ancien ingénieur allemand, il a été membre du parti nazi afin d’obtenir plus de financements pour ses programmes. Il participe activement au développement des V1 et V2 allemands. Son rêve a toujours été l’espace, mais ses inventions auront été utilisées pour fabriquer des armes en Allemagne, ainsi qu’aux États-Unis.
Malgré tout, il participera aux programmes Mercury et Gemini, qui sont des programmes de vols spatiaux habités, et il contribuera également au développement de la Saturne V pour le programme Apollo.
ESA : coopération et complémentarité
L’Agence spatiale européenne (ESA) réunit 22 États membres depuis 1975. Son siège à Paris coordonne l’exploration, l’observation de la Terre (programme Copernicus), et lance des fusées Ariane depuis Kourou.
L’ESA collabore étroitement avec la NASA, notamment sur l’ISS, et développe des missions indépendantes comme Rosetta (comète 67P) et ExoMars.
URSS : la conquête en premier
L’Union soviétique, via son bureau spatial Énergija (puis Glavkosmos), est le tout premier acteur majeur de la conquête spatiale. En 1957, le lancement de Spoutnik 1 marque le début de l’ère spatiale. En 1961, Youri Gagarine devient le premier homme dans l’espace à bord de Vostok 1.
Entre 1964 et 1969, la série Voskhod puis Soyouz affine les techniques de vol habité, tandis que les sondes Luna réalisent les premières photos de la face cachée de la Lune. Malgré la fin de l’URSS en 1991, ses infrastructures et ses équipes constituent la base de Roscosmos, qui assurait le transport vers l’ISS et mène des missions lunaires et martiennes.
NASA : la force historique
La National Aeronautics and Space Administration (NASA), créée en 1958, demeure l’agence spatiale la plus connue. Elle a mené les programmes Mercury, Gemini et Apollo, culminant avec le premier pas de l’homme sur la Lune en 1969.
Depuis, la NASA a développé les navettes spatiales, la station ISS, et les sondes vers Mars et les confins du système solaire.

Son expertise et son développement fulgurant sont dus en partie à Wernher von Braun. Ancien ingénieur allemand, il a été membre du parti nazi afin d’obtenir plus de financements pour ses programmes. Il participe activement au développement des V1 et V2 allemands. Son rêve a toujours été l’espace, mais ses inventions auront été utilisées pour fabriquer des armes en Allemagne, ainsi qu’aux États-Unis.
Malgré tout, il participera aux programmes Mercury et Gemini, qui sont des programmes de vols spatiaux habités, et il contribuera également au développement de la Saturne V pour le programme Apollo.
ESA : coopération et complémentarité
L’Agence spatiale européenne (ESA) réunit 22 États membres depuis 1975. Son siège à Paris coordonne l’exploration, l’observation de la Terre (programme Copernicus), et lance des fusées Ariane depuis Kourou.
L’ESA collabore étroitement avec la NASA, notamment sur l’ISS, et développe des missions indépendantes comme Rosetta (comète 67P) et ExoMars.
Les nouveaux acteurs de la conquête spatiale
Roscosmos : héritier de l’URSS
La Roscosmos State Corporation est l’héritière de l’agence soviétique qui a envoyé Youri Gagarine dans l’espace en 1961. Elle assurait aujourd’hui la fourniture des Soyouz pour transporter astronautes et vivres vers l’ISS, et conduit des missions robotisées vers la Lune et Mars.
CNSA : montée en puissance chinoise
La China National Space Administration (CNSA) a réalisé son premier vol habité en 2003 avec Shenzhou 5. Elle a posé un rover sur la face cachée de la Lune (mission Chang’e 4) et construit en orbite la station Tiangong.
Par son programme lunaire et martien, la Chine affirme sa place dans le cercle restreint des grandes puissances spatiales.
ISRO et JAXA : Inde et Japon
L’Indian Space Research Organisation (ISRO), fondée en 1969, a remporté plusieurs succès à moindre coût, comme l’insertion d’une sonde en orbite martienne dès 2014. Elle développe aussi des satellites d’observation et de télécommunications.
Le Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), créée en 2003, est connue pour ses missions Hayabusa (retour d’échantillons d’astéroïde) et ses projets de station lunaire.
Agences nationales et spécialisations
- CNES (France) : mère de l’ESA et responsable du Centre spatial guyanais, elle conçoit satellites d’observation et lance la fusée Vega.
- UKSA (Royaume-Uni) : partenaire de l’ESA, elle investit dans les lanceurs légers et l’observation spatiale.
- DLR (Allemagne) : agit pour la recherche aérospatiale et coopère avec l’ESA sur plusieurs grands programmes.
- CSA (Canada) : fournit des éléments robotiques pour l’ISS (canadarm) et développe des satellites scientifiques.
- CONAE (Argentine), AEB (Brésil), SANSA (Afrique du Sud) : acteurs régionaux qui mettent en œuvre des satellites d’imagerie pour la météo, l’agriculture et la sécurité.
Coopération, défis et perspectives
L’ISS symbolise la collaboration entre NASA, Roscosmos, ESA, JAXA et CSA. Les futurs projets de missions habitées vers la Lune (programme Artemis) et Mars reposent sur ce modèle.
Cependant, la multiplication des acteurs publics et privés soulève des enjeux de gouvernance : gestion des débris, équité d’accès aux orbites, et réglementation des activités lunaires et martiennes.
Quelques liens et sources utiles
Irénée Régnauld, Arnaud Saint-Martin, Une histoire de la conquête spatiale: Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space, La Fabrique Éditions, 2024